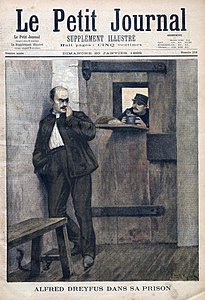Affaire Dreyfus
| Affaire Dreyfus | |
 Émile Zola, « J'accuse… ! » à la une du journal L'Aurore, . | |
| Titre | Affaire Alfred Dreyfus |
|---|---|
| Fait reproché | Espionnage |
| Chefs d'accusation | Espionnage et intelligence avec l'ennemi |
| Pays | |
| Ville | Paris |
| Jugement | |
| Statut | Condamné à la déportation à perpétuité et à la dégradation publique (1894) Condamné à dix ans de réclusion (1899) Acquitté le |
| Tribunal | Conseil de guerre de la prison du Cherche-Midi de Paris (1894) Conseil de guerre de la Xe région militaire de Rennes (1899) |
| Formation | Chambres réunies de la Cour de cassation (1906) |
| Date du jugement | |
| Recours | Requête en révision acceptée le Arrêt cassé le Gracié le Acquitté sans renvoi le |
| modifier |
|
L'affaire Dreyfus (prononcé : [afɛʁ dʁɛfys]) est une affaire d'État devenue un conflit social et politique majeur de la Troisième République, survenu en France à la fin du XIXe siècle autour de l'accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, qui est finalement innocenté. Elle bouleverse la société française pendant douze ans, de 1894 à 1906, la divisant profondément et durablement en deux camps opposés : les « dreyfusards », partisans de l'innocence de Dreyfus, et les « antidreyfusards », partisans de sa culpabilité.
La condamnation fin 1894 du capitaine Dreyfus — pour avoir prétendument livré des documents secrets français à l'Empire allemand — est une erreur judiciaire voire un complot judiciaire[1],[2] sur fond d'espionnage, dans un contexte social particulièrement propice à l'antisémitisme et à la haine de l'Allemagne (revanchisme) après son annexion de l'Alsace-Lorraine (Alsace-Moselle) en 1871. L'affaire rencontre au départ un écho limité, avant qu'en 1898 l'acquittement du véritable coupable et la publication d'un pamphlet dreyfusard par Émile Zola, « J'accuse… ! » ne provoquent une succession de crises politiques et sociales. À son paroxysme en 1899, l'affaire révèle les clivages de la France de la Troisième République, où l'opposition entre les camps dreyfusard et antidreyfusard suscite de très violentes polémiques nationalistes et antisémites, diffusées par une presse influente. Elle s'achève en 1906, par un arrêt de la Cour de cassation qui innocente et réhabilite définitivement Dreyfus.
Cette affaire est souvent considérée comme le symbole moderne et universel de l'iniquité[3] au nom de la raison d'État, et reste l'un des exemples les plus marquants d'une erreur judiciaire difficilement réparée, avec un rôle majeur joué par la presse et l'opinion publique.
Résumé

À la fin de l'année 1894, le capitaine de l'armée française Alfred Dreyfus, polytechnicien[4], Juif d'origine alsacienne, accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets, est condamné au bagne à perpétuité pour trahison et déporté sur l'île du Diable. À cette date, l'opinion comme la classe politique française est unanimement défavorable à Dreyfus.

Certaine de l'incohérence de cette condamnation, la famille du capitaine, derrière son frère Mathieu, tente de prouver son innocence, engageant à cette fin le journaliste Bernard Lazare. Parallèlement, le colonel Georges Picquart, chef du contre-espionnage, constate en que le vrai traître est le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy. L'état-major refuse pourtant de revenir sur son jugement et affecte Picquart en Tunisie.
Afin d'attirer l'attention sur la fragilité des preuves contre Dreyfus, sa famille décide de contacter en le respecté vice-président du Sénat Auguste Scheurer-Kestner qui fait savoir, trois mois plus tard, qu'il a acquis la conviction de l'innocence de Dreyfus, et qui en persuade également Georges Clemenceau, ancien député et alors simple journaliste. Le même mois, Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du ministère de la Guerre contre Walsin Esterhazy. Alors que le cercle des dreyfusards s'élargit, deux événements quasi simultanés donnent en une dimension nationale à l'affaire : Esterhazy est acquitté sous les acclamations des conservateurs et des nationalistes ; Émile Zola publie « J'accuse… ! », réquisitoire dreyfusard qui entraîne le ralliement de nombreux intellectuels. Un processus de scission de la France est entamé, et se prolonge jusqu'à la fin du siècle. Des émeutes antisémites éclatent dans plus de vingt villes françaises. On dénombre plusieurs morts à Alger. La République est ébranlée, certains la voient même en péril, ce qui incite à en finir avec l'affaire Dreyfus pour ramener le calme.
Malgré les menées de l'armée pour étouffer cette affaire, le premier jugement condamnant Dreyfus est cassé par la Cour de cassation au terme d'une enquête minutieuse, et un nouveau conseil de guerre a lieu à Rennes en 1899. Dreyfus est condamné une nouvelle fois, à dix ans de détention, avec circonstances atténuantes. Dreyfus accepte par la suite la grâce présidentielle, accordée par le président Émile Loubet. C'est en 1906 que son innocence est officiellement établie au travers d'un arrêt sans renvoi de la Cour de cassation[5]. Réhabilité, le capitaine Dreyfus est réintégré dans l'armée, sans la rétroactivité qui a été accordée au colonel Picquart, au grade de commandant et participe à la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1935.
Les conséquences de cette affaire sont innombrables et touchent tous les aspects de la vie publique française : politique (elle consacre le triomphe de la IIIe République, dont elle devient un mythe fondateur[6] tout en renouvelant le nationalisme), militaire, religieux (elle ralentit la réforme du catholicisme français, ainsi que l'intégration républicaine des catholiques), social, juridique, médiatique, diplomatique et culturel (c'est à l'occasion de l'affaire que le terme d'intellectuel est forgé). L'affaire a également un impact international sur le mouvement sioniste au travers de l'un de ses pères fondateurs, Theodor Herzl, et de par l'émoi que ces manifestations antisémites provoquent au sein des communautés juives d'Europe centrale et occidentale.
Contexte
Contexte politique

En 1894, la IIIe République est vieille de vingt-quatre ans. Le régime politique de la France vient d'affronter trois crises (le boulangisme en 1889, le scandale de Panama en 1892, et la menace anarchiste, réduite par les « lois scélérates » de ) qui n'ont fait que l'affermir. Les élections de 1893, centrées sur la « question sociale », ont consacré la victoire des républicains de gouvernement (un peu moins de la moitié des sièges) face à la droite conservatrice, ainsi que la force des radicaux (environ 150 sièges) et des socialistes (environ 50 sièges).
L'opposition des radicaux et des socialistes pousse à gouverner au centre, d'où des choix politiques orientés vers le protectionnisme économique, une certaine indifférence à la question sociale, une volonté de briser l'isolement international avec l'alliance russe[réf. nécessaire]. Cette politique de centre provoque l'instabilité ministérielle, certains républicains de gouvernement rejoignant parfois les radicaux, ou certains orléanistes rejoignant les légitimistes, et cinq gouvernements se succèdent de 1893 à 1896. Cette instabilité gouvernementale se double d'une instabilité présidentielle : au président Sadi Carnot, assassiné le [7], succède le modéré Jean Casimir-Perier qui démissionne le [8] et est remplacé par Félix Faure.
À la suite de l'échec du gouvernement radical de Léon Bourgeois en 1896, le président nomme Jules Méline, homme du protectionnisme sous Ferry. Son gouvernement prend acte de l'opposition de la gauche et de certains républicains (l'Union progressiste notamment) et fait en sorte de toujours obtenir le soutien de la droite. Très stable, il cherche à apaiser les tensions religieuses (ralentissement de la lutte anticléricale), sociales (vote de la loi sur la responsabilité des accidents du travail) et économiques (maintien du protectionnisme) en conduisant une politique assez conservatrice. C'est sous ce gouvernement stable qu'éclate réellement l'Affaire Dreyfus[9].
Contexte militaire

L'affaire Dreyfus se place dans le cadre de l'annexion à l'Allemagne de l'Alsace et de la Moselle, déchirure qui alimente les nationalismes les plus extrêmes. La défaite traumatisante de 1870 semble loin, mais l'esprit revanchard est toujours présent. De nombreux acteurs de l'affaire Dreyfus sont d'ailleurs alsaciens[n 1].
Les militaires exigent des moyens considérables pour préparer le prochain conflit, et c'est dans cet esprit que l'alliance franco-russe, que certains considèrent « contre nature »[n 2] est signée le sur la base d'une convention militaire secrète. L'armée s'est relevée de la défaite, mais elle est encore en partie constituée d'anciens cadres socialement aristocrates et politiquement monarchistes. Le culte du drapeau et le mépris de la République parlementaire sont deux principes essentiels à l'armée de l'époque[10]. La République a beau célébrer son armée avec régularité, l'allégorie de la République est presque absente des enceintes militaires.
Mais depuis une dizaine d'années, l'armée connaît une mutation importante, dans le double but de la démocratiser et de la moderniser. Des polytechniciens concurrencent efficacement les officiers issus de la voie royale de Saint-Cyr[4], ce qui amène des dissensions, amertumes et jalousies parmi ceux des sous-officiers qui s'attendaient à des promotions au choix.
La période est aussi marquée par une course aux armements qui touche principalement l'artillerie, avec des perfectionnements concernant l'artillerie lourde (obusiers de 120 court et de 155 court, modèles 1890 Baquet, à nouveaux freins hydropneumatiques), mais aussi et surtout, la mise au point de l'ultra secret canon de 75[11].
Le renseignement, activité organisée et outil de guerre secrète, est une nouveauté de la fin du XIXe siècle. Le contre-espionnage militaire, alias « Section de statistiques », est créé en 1871 mais ne compte alors qu'une poignée d'officiers et de civils. Son chef en 1894 est le lieutenant-colonel Jean Sandherr, saint-cyrien, alsacien de Mulhouse, antisémite convaincu. Sa mission militaire est claire : récupérer des renseignements sur l'ennemi potentiel de la France, et l'intoxiquer avec de fausses informations. La « Section de statistiques » est épaulée par le service des « Affaires réservées » du quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, animé par un jeune diplomate, Maurice Paléologue. La course aux armements amène une ambiance d'espionnite aiguë dans le contre-espionnage français à partir de 1890. Aussi, l'une des missions de la section consiste à espionner l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille (hôtel Beauharnais), à Paris, afin de déjouer toute tentative de transmission d'informations importantes à cet adversaire. D'autant que plusieurs affaires d'espionnage avaient déjà défrayé la chronique d'une presse friande de ces histoires mêlant le mystère au sordide. Ainsi en 1890, l'archiviste Boutonnet est condamné pour avoir vendu les plans de l'obus à la mélinite. L'attaché militaire allemand à Paris est en 1894 le comte Maximilian von Schwartzkoppen, qui développe une politique d'infiltration qui semble avoir été efficace.
Depuis le début 1894, la Section de statistiques enquête sur un trafic de plans directeurs concernant Nice et la Meuse, mené par un agent que les Allemands et les Italiens surnomment Dubois[n 3]. C'est ce qui l'amène aux origines de l'affaire Dreyfus.
Contexte social

Le contexte social est marqué par la montée du nationalisme et de l'antisémitisme.
Cette croissance de l'antisémitisme, très virulente depuis la publication de La France juive d'Édouard Drumont en 1886 (150 000 exemplaires la première année), va de pair avec une montée du cléricalisme. Les tensions sont fortes dans toutes les couches de la société, attisées par une presse influente et pratiquement libre d'écrire et de diffuser n'importe quelle information, fût-elle injurieuse ou diffamatoire. Les risques juridiques sont limités si la cible est une personne privée.
L'antisémitisme n'épargne pas l'institution militaire qui pratique des discriminations occultes, jusque dans les concours, avec la fameuse « cote d'amour », notation subjective d’appréciation d’aptitude au service d’état-major. Dreyfus, qui avait brillamment réussi ses examens, s’était ainsi vu attribuer un 5 par le général Bonnefond à l'école d'application de Bourges[12], note que partagea le seul autre de ses condisciples juif[13]. Témoin des fortes tensions de cette époque, la vogue du duel, à l'épée ou au pistolet, provoquant parfois la mort d'un des deux duellistes. Des officiers juifs, atteints par une série d'articles de presse de La Libre Parole[14], accusés de « trahir par naissance », défient leurs rédacteurs. Ainsi en est-il du capitaine Crémieu-Foa, Juif alsacien et polytechnicien qui se bat sans résultat contre Drumont[n 4],[15], puis contre M. de Lamase, auteur des articles. Mais le capitaine Mayer, autre officier juif, est tué par le marquis de Morès, ami de Drumont, dans un autre duel ; décès qui déclenche une émotion considérable, très au-delà des milieux israélites.
La haine des Juifs est désormais publique, violente, alimentée par un brûlot diabolisant la présence juive en France qui représente alors au plus 80 000 personnes en 1895 (dont 40 000 à Paris), plus 45 000 en Algérie. Le lancement de La Libre Parole, dont la diffusion estimée est de 200 000 exemplaires[16] en 1892, permet à Drumont d'élargir encore son audience vers un lectorat plus populaire, déjà tenté par l'aventure boulangiste dans le passé. L'antisémitisme diffusé par La Libre Parole, mais aussi par L'Éclair, Le Petit Journal, La Patrie, L'Intransigeant, La Croix, développant un antisémitisme présent dans certains milieux catholiques, atteint des sommets[17].
Origines de l'affaire et procès de 1894
À l'origine : les faits d'espionnage

L'origine de l'affaire Dreyfus, bien que totalement éclaircie depuis les années 1960[18], a suscité de nombreuses controverses pendant près d'un siècle. Il s'agit d'une affaire d'espionnage dont les intentions sont restées obscures jusqu'à nos jours. De nombreux historiens parmi les plus éminents expriment plusieurs hypothèses distinctes sur l'affaire[n 5], mais tous arrivent à une conclusion unique : Dreyfus était innocent.
Découverte du bordereau
Le personnel du Service de Renseignements militaire (SR) a affirmé de manière constante[19] qu'en septembre 1894, la « voie ordinaire »[n 6] avait apporté[n 7] au contre-espionnage français une lettre, surnommée par la suite « le bordereau ». Cette lettre-missive, déchirée en six grands morceaux[n 8], écrite sur du papier pelure, non signée et non datée, était adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne, Maximilian von Schwartzkoppen. Elle établissait que des documents militaires confidentiels, mais d'importance relative[n 9], étaient sur le point d'être transmis à une puissance étrangère. C'est madame Bastian, employée comme femme de ménage, mais en fait membre des services d'espionnage qui l'a rapportée. Elle collectait le contenu des corbeilles de l'ambassade d'Allemagne, qu'elle remettait soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines, au commandant Henry dans la pénombre d'une chapelle de l'église Sainte-Clotilde[23].
Recherche de l'auteur du bordereau

Cette prise semble suffisamment importante pour que le chef de la « Section de statistiques »[24], le mulhousien[25] Jean Sandherr, en informe le ministre de la Guerre, le général Auguste Mercier. Le SR soupçonne en effet des fuites depuis le début de l'année 1894, et recherche leur auteur. Le ministre, violemment attaqué dans la presse pour son action jugée incompétente[26], semble vouloir tirer parti de cette affaire pour rehausser son image[27],[28]. Il diligente immédiatement deux enquêtes secrètes, l'une administrative et l'autre judiciaire. Pour trouver le coupable, le raisonnement est simple sinon grossier[29] : le cercle de recherche est arbitrairement restreint à un suspect en poste ou un ancien collaborateur à l'état-major, nécessairement artilleur sur les indications du capitaine Matton, seul artilleur de la Section de statistiques, car trois des documents transmis concernaient l'artillerie de près ou de loin, et officier stagiaire, puisque les documents provenaient des 1er, 2e, 3e et 4e bureaux, un stagiaire semblant seul à même de proposer une telle variété de documents, car ceux-ci passaient de bureau en bureau pour parfaire leur formation. Ce raisonnement du lieutenant-colonel d'Aboville se révéla faux[30].
Le coupable idéal est identifié : le capitaine Alfred Dreyfus, polytechnicien et artilleur[4], de confession israélite et alsacien d'origine, issu de la méritocratie républicaine[31]. Au tout début de l'affaire, on insiste sur les origines alsaciennes de Dreyfus plutôt que sur son appartenance religieuse. Celles-ci n'étaient pourtant pas exceptionnelles, puisqu'on privilégiait les officiers de l'est de la France pour leur double connaissance de la langue allemande et de la culture germanique[32],[33]. Mais l'antisémitisme, qui n'épargne pas les bureaux d'état-major[34], devient rapidement le centre de l'affaire d'instruction, remplissant les vides d'une enquête préliminaire très sommaire[29]. D'autant que Dreyfus était à ce moment-là le seul officier juif étant passé récemment par l'état-major général.
De fait, la légende[n 10] du caractère froid et renfermé, voire hautain de l'homme, et de sa « curiosité », jouent fortement contre lui. Ces traits de caractère, les uns faux, les autres naturels, rendent plausibles toutes les accusations en transformant les actes les plus ordinaires de la vie courante dans un ministère, en faits avérés d'espionnage. Ce début d'instruction partial et partiel amène une multiplication d'erreurs qui conduisent au mensonge d'État. Ceci au travers d'une affaire où l'irrationnel l'emporte sur le positivisme pourtant en vogue à cette époque[36] :
« Dès cette première heure s'opère le phénomène qui va dominer toute l'affaire. Ce ne sont plus les faits contrôlés, les choses examinées avec soin qui forment la conviction ; c'est la conviction souveraine, irrésistible, qui déforme les faits et les choses. »
Expertises en écriture

Pour confondre Dreyfus, les écritures du bordereau et du capitaine sont comparées. Personne n'est compétent en matière d'analyse d'écritures à l'état-major[37]. Entre alors en scène le commandant du Paty de Clam[38],[39], homme original qui se pique d'expertise en écritures. Mis en présence de lettres de Dreyfus et du bordereau le 5 octobre, du Paty conclut d'emblée à l'identité des deux écritures. Après une journée de travail complémentaire, il assure dans un rapport que, malgré quelques dissemblances, les ressemblances sont suffisantes pour justifier une enquête. Dreyfus est donc « l'auteur probable » du bordereau pour l'état-major[40].

Le général Mercier tenant un coupable, il met exagérément en valeur l'affaire, qui prend le statut d'affaire d'État pendant la semaine précédant l'arrestation de Dreyfus. En effet, le ministre consulte et informe toutes les autorités de l'État[n 11]. Malgré les conseils de prudence[n 12] et les objections courageusement exprimées par Gabriel Hanotaux lors d'un petit conseil des ministres[42], il décide de poursuivre[43]. Du Paty de Clam est nommé officier de police judiciaire chargé d'une enquête officielle.
Pendant ce temps, plusieurs informations sont ouvertes parallèlement, les unes sur la personnalité de Dreyfus et les autres consistant à s'assurer de la réalité des identités d'écriture. L'expert Gobert[n 13] n'est pas convaincu, trouve de nombreuses différences et écrit même que « la nature de l'écriture du bordereau exclut le déguisement graphique »[44]. Déçu, Mercier fait alors appel à Alphonse Bertillon, l'inventeur de l'anthropométrie judiciaire, mais nullement expert en écritures. Il n'est d'abord pas plus affirmatif que Gobert, en n'excluant pas une copie de l'écriture de Dreyfus[45]. Mais par la suite, sous la pression des militaires[46], il affirme que Dreyfus s'est autocopié et développe sa théorie de l'« autoforgerie ».
Selon le procureur général Jean-Pierre Manau, Alphonse Bertillon, ramenant tout à des questions de mensuration, aurait pu être « hypnotisé, possédé en quelque sorte par un souvenir, celui de l'affaire de la Boussinière »[47]. Joseph Reinach le dira aussi « obsédé par le souvenir du testament de la Boussinière »[48]. En outre, deux experts, dont Bertillon, ayant expertisé le faux testament comme authentique dans l'affaire de la Boussinière, sont précisément au nombre des trois qui déclarent que le document est bien de la main de Dreyfus, ce qui ne manque pas d'interpeller[49].
L'arrestation
Le 13 octobre, sans preuve tangible et avec un dossier vide, le général Mercier fait convoquer le capitaine Dreyfus pour une inspection générale, en « tenue bourgeoise », c'est-à-dire en civil. L'objectif de l'état-major est de gagner la preuve parfaite en droit français : l'aveu. Cet aveu serait obtenu par effet de surprise, en faisant écrire une lettre inspirée du bordereau[50] au coupable[51] sous la dictée.
Le au matin, le capitaine Dreyfus subit cette épreuve, mais n'avoue rien. Du Paty tente même de lui suggérer le suicide en plaçant un revolver devant Dreyfus, mais l'accusé refuse d'attenter à ses jours, affirmant qu'il « veut vivre afin d'établir son innocence ». L'espoir des militaires est déçu. Du Paty de Clam fait tout de même arrêter le capitaine[52] et l'inculpe d'intelligence avec l'ennemi afin qu'il soit traduit devant un conseil de guerre. Dreyfus est incarcéré à la prison du Cherche-Midi à Paris[53].
L'instruction et le premier conseil de guerre

Lucie Dreyfus est informée de l'arrestation de son époux le jour même, par une perquisition de l'appartement du jeune couple. Elle est terrorisée par du Paty qui lui ordonne de garder le secret sur l'arrestation de son mari, et lui affirme même : « Un mot, un seul mot et c'est la guerre européenne ! »[54] En toute illégalité[n 14], Dreyfus est mis au secret dans sa prison où Du Paty l'interroge jour et nuit afin d'obtenir des aveux, ce qui échoue et incite le lieutenant-colonel à recommander l'abandon des poursuites en l'absence de preuves, par crainte d'être désavoué par une cour de justice[56]. Le capitaine est soutenu moralement par le premier dreyfusard : le commandant Ferdinand Forzinetti, commandant les prisons militaires de Paris[53].
Le , l'affaire est révélée par un entrefilet d'Adrien Papillaud dans le journal antisémite d'Édouard Drumont, La Libre Parole, marquant ainsi le début d'une très violente campagne de presse jusqu'au procès. Cet événement place l'Affaire sur le terrain de l'antisémitisme, qu'elle ne quitte plus jusqu'à sa conclusion définitive[57].
Le , Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred, appelé d'urgence à Paris, est mis au courant de l'arrestation. Il devient l'artisan du combat difficile pour la libération de son frère[58]. Sans attendre, il se met à la recherche d'un avocat, et retient l'éminent pénaliste Edgar Demange.
L'instruction
Le 3 novembre, à contrecœur[59], le général Saussier donne l'ordre d'informer. Il a tous les pouvoirs pour arrêter la machinerie, mais il ne le fait pas, peut-être par confiance exagérée en la justice militaire[60].
Le commandant d'Ormescheville, rapporteur auprès du Conseil de guerre, rédige un rapport à charge dans lequel les « éléments moraux » de l'accusation (qui vont de ragots concernant les mœurs de Dreyfus et sa prétendue fréquentation de « cercles-tripots » à sa connaissance de l'allemand et sa « mémoire remarquable ») sont développés bien plus longuement que les « éléments matériels »[n 15].
Les éléments matériels sont traités dans l'unique avant-dernier paragraphe, en une phrase : « [les éléments matériels] consistent en la lettre missive incriminée, dont l'examen par la majorité des experts aussi bien que par nous et par les témoins qui l'ont vue, a présenté, sauf dissemblances volontaires, une similitude complète avec l'écriture authentique du capitaine Dreyfus ». Cette rareté même sert à la charge : « c'est une preuve de culpabilité, car Dreyfus a tout fait disparaître ». Le manque complet de neutralité de l'acte d'accusation conduit Émile Zola à le qualifier de « monument de partialité »[61].
Le 4 décembre, avec ce dossier, Dreyfus est renvoyé devant le premier Conseil de guerre. Le secret est levé et Me Demange peut pour la première fois accéder au dossier. Après sa lecture, la confiance de l'avocat est absolue[62]. L'accusation repose sur l'écriture d'une pièce unique, le bordereau, à propos de laquelle les experts se contredisent, et sur de vagues témoignages indirects.
Le procès : « Le huis clos ou la guerre ! »

Pendant les deux mois précédant le procès, la presse se déchaîne. La Libre Parole, L'Autorité, Le Journal, Le Temps racontent toute la vie de Dreyfus au travers de récits orientés par l'État-major[63]. C'est aussi l'occasion pour La Libre Parole ou La Croix, de justifier leurs campagnes antérieures contre la présence de Juifs dans l'armée, sur le thème « On vous l'avait bien dit ! »[64]. Cette période longue est surtout le moyen pour l'état-major de préparer l'opinion et de faire pression indirectement sur les juges[65]. Ainsi le , le général Mercier va jusqu'à déclarer Dreyfus coupable dans une interview au Figaro[66],[67]. Lui réplique le un article d'Arthur Meyer dans Le Gaulois, dans lequel est condamné le réquisitoire fait contre Dreyfus et demandé : « Quelle liberté restera-t-il au Conseil de Guerre appelé à juger ce prévenu ? »[68],[69].

Des joutes d'éditorialistes ont lieu au sein d'un large débat à propos de la question du huis clos. Pour Ranc et Cassagnac qui représentent la majorité de la presse, le huis clos est une manœuvre basse dans le but de permettre l'acquittement de Dreyfus, « car le ministre est un lâche ». La preuve c'est « qu'il rampe devant les Prussiens » en acceptant de publier des démentis de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris[n 16]. Mais pour d'autres journaux, comme L'Éclair du , « le huis clos est nécessaire pour éviter un casus belli », alors que pour Judet dans Le Petit Journal du 18, « le huis clos est notre refuge inexpugnable contre l'Allemagne » ou le chanoine de La Croix du même jour, il faut « le huis clos le plus absolu »[70]. Le 21 décembre, La Croix emploie la formule « Le huis clos ou la guerre »[71],[n 17].
Le procès s'ouvre le à treize heures[73], le huis clos étant presque immédiatement prononcé. Ce huis clos n'est d'ailleurs pas conforme au droit puisque le commandant Picquart et le préfet Louis Lépine sont présents à certaines audiences en violation du droit, mesure qui permet néanmoins aux militaires de ne pas divulguer le contenu du dossier au grand public[74] et d'étouffer les débats[75]. Les discussions de fond sur le bordereau montrent que l'hypothèse que le capitaine Dreyfus en soit l'auteur rencontre de très nombreuses contradictions[76],[77]. D'autre part, l'accusé clame son innocence, et se défend point par point[78]. Ses déclarations sont appuyées par une dizaine de témoignages à décharge. La question d'un mobile pécuniaire est posée dans le dossier d'accusation, mais Dreyfus était aisé : alors qu'il était capitaine, il avait des revenus personnels équivalents à ceux d'un général commandant de région[79], issus de l'héritage de son père et de la dot de sa femme. Il n'avait donc aucune raison pécuniaire de trahir. La justification par la judéité de Dreyfus, seule retenue par la presse de droite, ne saurait pourtant l'être par un tribunal.
Alphonse Bertillon est présenté à la cour comme un savant de première importance. Il avance la théorie de l'autoforgerie à l'occasion de ce procès et accuse Dreyfus d'avoir imité sa propre écriture, expliquant les différences graphiques par l'emploi d'extraits de l'écriture de son frère Mathieu et de son épouse Lucie. Cette théorie, bien que considérée plus tard comme farfelue et sidérante[n 18] semble avoir un certain effet sur les juges. De plus, le commandant Hubert-Joseph Henry, adjoint du chef du SR et découvreur du bordereau, fait une déclaration théâtrale[81] en pleine audience. Il affirme qu'une suspicion de fuites existait depuis le mois de à propos d'une trahison à l'état-major et « qu'une personne honorable » accusait le capitaine Dreyfus. Il jure sur l'honneur que le traître est Dreyfus, en désignant le crucifix accroché au mur du tribunal[82]. Dreyfus sort de ses gonds et exige d'être confronté à son accusateur anonyme, ce qui est refusé par l'état-major. L'incident a un effet incontestable sur la cour, composée de sept officiers qui sont à la fois juges et jurés. Toutefois, l'issue du procès est incertaine. La conviction des juges a été ébranlée par l'attitude ferme et les réponses logiques de l'accusé[83]. Les juges partent délibérer. Mais l'état-major a encore une carte en main pour faire pencher la balance définitivement contre Dreyfus.
Transmission d'un dossier secret aux magistrats


Les témoins militaires du procès alertent le commandement sur les risques d'acquittement. Dans cette éventualité, la Section de statistiques avait préparé un dossier, contenant, en principe, quatre preuves « absolues » de la culpabilité du capitaine Dreyfus, accompagnées d'une note explicative. Le contenu de ce dossier secret est incertain encore de nos jours, car aucune archive dressant la liste des pièces ne nous est parvenue. Des recherches récentes[84] indiquent l'existence d'une numérotation induisant peut-être la présence d'une dizaine de documents. Parmi ceux-ci, des lettres à caractère érotico-homosexuel ("Lettre Davignon" entre autres) posent la question des méthodes d'intoxication du Service de statistiques et de l'objet de ce choix documentaire.
Le dossier secret est remis au début du délibéré, en toute illégalité, au président du Conseil de guerre le colonel Émilien Maurel, sur ordre du ministre de la Guerre, le général Mercier. En effet, en droit militaire français de l'époque, toutes les preuves de culpabilité doivent être remises à la défense afin d'être débattues contradictoirement, ce qui n'était pas obligatoire pour la justice ordinaire[85]. Plus tard, au procès de Rennes de 1899, le général Mercier a expliqué que la nature même des pièces soumises interdisait leur divulgation dans l'enceinte du tribunal. Ce dossier contenait, outre des lettres sans grand intérêt, dont certaines étaient truquées[86], une pièce restée célèbre sous le nom de « Canaille de D… ».
C'était une lettre de l'attaché militaire allemand Maximilian von Schwartzkoppen à l'attaché militaire italien Alessandro Panizzardi interceptée par le SR. La missive était censée accuser définitivement Dreyfus, puisque d'après ses accusateurs, il était désigné par l'initiale de son nom[n 19]. En réalité, la Section de statistiques savait que la lettre ne pouvait pas incriminer Dreyfus, et si elle le fit, ce fut par intention criminelle[88]. Le colonel Maurel a affirmé au second procès Dreyfus[89] que les pièces secrètes n'avaient pas servi à emporter l'adhésion des juges du Conseil de guerre. Mais il se contredit en affirmant qu'il a lu un seul document, « ce qui fut suffisant ».
Condamnation, dégradation et déportation

Le 22 décembre, après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe. À l'unanimité des sept juges, Alfred Dreyfus est condamné pour intelligence avec une puissance étrangère à la peine maximale applicable en vertu de l'article 76 du code pénal, la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, c'est-à-dire au bagne, ainsi qu'à la destitution de son grade et à la dégradation militaire. Dreyfus n'est pas condamné à mort, cette peine ayant été abolie pour les crimes politiques depuis 1848.

(Le Monde illustré, ).
Pour les autorités, la presse et le public, les quelques doutes d'avant procès sont dissipés ; la culpabilité est certaine. Jean Jaurès (très anti-dreyfusard à ce moment là, mais qui changera d'opinion) se sert comme argument contre la peine de mort, d'une condamnation qui laisse la vie à un « misérable traître » : « un troupier vient d'être condamné à mort et exécuté pour avoir lancé un bouton au visage de son caporal. Alors pourquoi laisser ce misérable traître en vie ? »[réf. nécessaire] Clemenceau, dans La Justice, fait une remarque similaire[n 20]. L'antisémitisme atteint par ailleurs des sommets dans la presse et se manifeste dans des populations jusqu'à présent épargnées[92].
Le , le commandant du Paty se rend à la prison et propose à Dreyfus un allégement de sa peine en échange de ses aveux, ce que le capitaine refuse[93].
Le , la cérémonie de la dégradation se déroule dans la Cour Morland de l'École militaire à Paris où quatre mille soldats formés en carré entourent le « traître » tandis que 20 000 personnes s'amassent derrière les foules : alors que les tambours roulent, Dreyfus est accompagné par quatre artilleurs qui l'amènent devant un huissier qui lui lit le jugement. Un adjudant de la Garde républicaine lui arrache les insignes, les fines lanières d'or de ses galons, les parements des manches et de la veste. Les témoins signalent la dignité de Dreyfus, qui continue de clamer son innocence tout en levant les bras : « Soldats, on dégrade un innocent, soldats on déshonore un innocent. Vive la France ! Vive l'armée ! »[94]. L'adjudant brise le sabre du condamné sur son genou puis Dreyfus défile au ralenti devant ses anciens compagnons[95]. La veille, les galons et boutons sont décousus et le sabre scié pour faciliter la dégradation[96].
Un évènement, que l'on surnomme « la légende des aveux »[97], s'est déroulé avant la dégradation. Dans le fourgon qui l'amenait à l'École militaire, Dreyfus aurait confié sa traîtrise au capitaine Lebrun-Renault[98]. Il apparaît qu'en réalité, le capitaine de la Garde républicaine s'est vanté et que Dreyfus n'avait fait aucun aveu[5]. Du fait de la nature de l'affaire, touchant à la sécurité nationale, le prisonnier est mis au secret dans une cellule en attendant son transfert. Le 17 janvier, il est transféré au bagne de l'île de Ré, où il est maintenu plus d'un mois. Il a le droit de voir sa femme deux fois par semaine, dans une salle allongée, chacun à un bout, le directeur de la prison au milieu[99].
À la dernière minute, à l'initiative du général Mercier, un projet de loi est transmis au conseil des ministres, rétablissant les îles du Salut en Guyane comme lieu de déportation en enceinte fortifiée, afin que Dreyfus ne soit pas envoyé à Ducos, en Nouvelle-Calédonie[100]. En effet, lors de la déportation de l'adjudant Lucien Châtelain, condamné pour intelligence avec l'ennemi en 1888, notamment, les conditions de détentions à Ducos étaient apparues trop douces, lui ayant notamment permis de tenter une évasion[101]. Émile Chautemps, nouveau ministre des Colonies depuis le , demande peu de jours après sa nomination que le projet soit porté devant la Chambre. Le , sachant par avance que la loi sera votée, il écrit au gouverneur de la Guyane, Camille Charvein, pour faire part des inquiétudes du gouvernement, et des instructions que le gouverneur aura à appliquer lorsque Dreyfus sera sous sa responsabilité. Le , le projet de loi est adopté par la Chambre, sans débat[100].
Le 21 février, Dreyfus embarque sur le vaisseau Ville-de-Saint-Nazaire. Le lendemain, le navire fait cap vers la Guyane.
Le 12 mars, après une traversée pénible de quinze jours, le navire mouille au large des îles du Salut. Dreyfus reste un mois au bagne de l'île Royale, puis il est transféré à l'île du Diable le 14 avril. Avec ses gardiens, il est le seul habitant de l'île, logeant dans une case de pierre de quatre mètres sur quatre[102]. Hanté par le risque de l'évasion, le commandant du bagne fait vivre un enfer au condamné alors que les conditions de vie sont déjà très pénibles : la température atteint 45 °C, il est sous-alimenté ou nourri de denrées frelatées, pratiquement pas soigné de ses nombreuses maladies tropicales. Dreyfus tombe malade, secoué par les fièvres qui s'aggravent d'année en année[103].
Dreyfus est autorisé à écrire sur un papier numéroté et paraphé. Ce qu'il écrit subit la censure du commandement, comme les courriers échangés avec sa femme Lucie, par lesquels ils s'encouragent mutuellement. Le , les conditions de vie d'Alfred Dreyfus s'aggravent encore : il est mis à la double boucle, supplice obligeant le forçat à rester sur son lit, immobile, les chevilles entravées. Cette mesure est la conséquence de la fausse information de son évasion, lancée par un journal anglais. Pendant deux longs mois, elle plonge Dreyfus dans un profond désespoir. À ce moment, il est persuadé que sa vie s'achèvera sur cette île lointaine[104].
-
La case de Dreyfus sur l'île du Diable en Guyane. -
Une du Petit Journal (). -
Une du Petit Journal (). -
Photographie de Dreyfus à l'île du Diable, 1898.
La vérité en marche (1895-1897)
La famille Dreyfus découvre l'affaire et agit

Mathieu Dreyfus, le frère aîné d'Alfred Dreyfus, est convaincu de l'innocence du condamné. Il est le premier artisan de la réhabilitation de son frère, et passe tout son temps, toute son énergie et sa fortune à rassembler autour de lui un mouvement de plus en plus puissant en vue de la révision du procès de , malgré les difficultés de la tâche[105] : « Après la dégradation, le vide se fit autour de nous. Il nous semblait que nous n'étions plus des êtres comme les autres, que nous étions comme retranchés du monde des vivants »[106].
Mathieu essaie toutes les pistes, y compris les plus étonnantes. Ainsi, grâce au docteur Gibert, ami du président Félix Faure, il rencontre au Havre une femme qui, sous hypnose, lui parle pour la première fois d'un « dossier secret »[107],[108]. Le fait est confirmé par le président de la République au docteur Gibert dans une conversation privée.
Petit à petit, malgré les menaces d'arrestation pour complicité, les filatures, les pièges tendus par les militaires[109], il réussit à convaincre divers modérés. Ainsi, le journaliste libertaire Bernard Lazare se penche sur les zones d'ombre de la procédure. En 1896, Lazare publie à Bruxelles le premier opuscule dreyfusard[110]. Cette publication n'a que peu d'influence sur le monde politique et intellectuel, mais elle contient tant de détails que l'état-major suspecte le nouveau chef du SR, Picquart, d'en être responsable.
Bernard Lazare, a lors de cette affaire « déployé pour l’une des premières fois en France une forme de journalisme d’investigation »[111], qui a eu pour fonction de « dénoncer les mensonges officiels, en donnant à connaître au public des faits et des documents, cachés, jusque-là, à sa connaissance », selon le sociologue des médias Jean-Marie Charon[111].
La campagne en faveur de la révision, relayée petit à petit dans la presse de gauche antimilitariste[112], déclenche en retour une vague d'antisémitisme très violente dans l'opinion. La France reste alors très majoritairement antidreyfusarde. Le commandant Henry, à la Section de statistiques, est de son côté conscient de la fragilité du dossier d'accusation. À la demande de sa hiérarchie, le général de Boisdeffre, chef d'état-major général, et le général Gonse, il est chargé de faire grossir le dossier afin d'éviter toute tentative de révision. Incapable de trouver la moindre preuve, il décide d'en fabriquer une a posteriori.
La découverte du vrai coupable par Picquart, qui « passe à l'ennemi »

Le vrai coupable de la trahison est découvert par hasard de deux manières distinctes ; par Mathieu Dreyfus d'une part, en recueillant la dénonciation du banquier Jacques de Castro, et par le Service de Renseignements militaire (SR) d'autre part, à la suite d'une enquête. Le colonel Sandherr étant tombé malade, le lieutenant-colonel Georges Picquart est affecté à la tête du SR en . En , Picquart, qui avait suivi l'affaire Dreyfus dès son origine[n 21], exige désormais de recevoir directement les documents recueillis par Mme Bastian à l'ambassade d'Allemagne, sans intermédiaire[113]. Il y découvre un document surnommé le « petit bleu » : une carte télégramme ni datée ni signée destinée à être envoyée via le réseau pneumatique de Paris, jamais envoyée, écrite par von Schwartzkoppen et interceptée à l'ambassade d'Allemagne début [114]. Celle-ci est adressée à un officier français, le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance, Paris[115]. Par ailleurs, une autre lettre au crayon noir de von Schwartzkoppen démontre cette relation d'espionnage avec Esterhazy[116].
Mis en présence de lettres de cet officier, Picquart s'aperçoit avec stupéfaction que son écriture est exactement la même que celle du « bordereau » qui a servi à incriminer Dreyfus. Il se procure le « dossier secret » remis aux juges en 1894, et devant sa vacuité, acquiert la certitude de l'innocence de Dreyfus.

|

| |
Esterhazy en uniforme du 74e d'infanterie (photographie anonyme) et caricaturé aux bras de deux élégantes « cocottes » (carte postale italienne dreyfusarde, vers 1898).
| ||
Très ému par sa découverte, Picquart diligente une enquête en secret, sans l'accord de ses supérieurs[117]. Elle démontre qu'Esterhazy avait connaissance des éléments décrits par le « bordereau » et qu'il était bien en contact avec l'ambassade d'Allemagne[118]. Il est établi que l'officier vendait aux Prussiens de nombreux documents secrets dont la valeur était cependant assez faible[119].
Ferdinand Walsin Esterhazy est un ancien membre du contre-espionnage français[120], où il avait servi après la Guerre de 1870. Il avait travaillé dans le même bureau que le commandant Henry de 1877 à 1880[121]. Homme à la personnalité trouble, à la réputation sulfureuse[122], criblé de dettes, il est pour Picquart le traître probable animé par un mobile certain : l'argent. Picquart communique alors les résultats de son enquête à l'état-major, qui lui oppose « l'autorité de la chose jugée ». Désormais, tout est fait pour l'évincer de son poste, avec l'aide de son propre adjoint, le commandant Henry. Il s'agit avant tout, dans les hautes sphères de l'Armée, de ne pas admettre que la condamnation de Dreyfus puisse être une grave erreur judiciaire. Pour les ministres, Mercier puis Zurlinden, et pour l'état-major, ce qui est fait est fait, on ne revient jamais en arrière[123]. Il convient alors de séparer les affaires Dreyfus et Esterhazy.
La dénonciation de Walsin Esterhazy et les progrès du dreyfusisme
La presse nationaliste lance une violente campagne contre le noyau dur naissant des dreyfusards. En contre-attaquant, l'état-major se découvre et révèle des informations, ignorées jusque-là, sur le « dossier secret »[124]. Le doute commence à s'installer et des figures des milieux artistiques et politiques s'interrogent[n 22]. Picquart tente de convaincre ses chefs de réagir en faveur de Dreyfus, mais l'état-major semble sourd. Une enquête est instruite contre lui, il est surveillé, éloigné dans l'Est, puis muté en Tunisie « dans l'intérêt du service »[125].

C'est le moment que choisit le commandant Henry pour passer à l'action. Le , il fabrique un faux, le « faux Henry »[n 23], en conservant l'entête et la signature[n 24] d'une lettre quelconque de Panizzardi[n 25], en rédigeant lui-même le texte central :
« J'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Si on demande à Rome nouvelles explications, je dirai que jamais j'avais les relations avec ce Juif. C'est entendu. Si on vous demande, dites comme ça, car il ne faut pas qu'on sache jamais personne ce qui est arrivé avec lui. »

C'est un faux assez grossier. Les généraux Gonse et Boisdeffre, sans se poser de questions, amènent cependant la lettre à leur ministre le général Billot. Les doutes de l'État-Major concernant l'innocence de Dreyfus s'envolent[127]. Fort de cette trouvaille, l'état-major décide de protéger Esterhazy et de persécuter[128] le colonel Picquart, « qui n'a rien compris ». Picquart, qui ignore tout du faux Henry, se sent rapidement isolé de ses collègues militaires. Littéralement accusé de malversations par le commandant Henry[129], il proteste par écrit et rentre à Paris.
Picquart se confie à son ami, l'avocat Louis Leblois, à qui il fait promettre le secret. Ce dernier en parle pourtant au vice-président du Sénat, l'alsacien Auguste Scheurer-Kestner, lequel est à son tour touché par le doute. Sans citer Picquart, le sénateur révèle l'affaire aux plus hautes personnalités du pays. Mais l'état-major soupçonne quand même Picquart d'être à l'origine des fuites. C'est le début de l'affaire Picquart[130], une nouvelle conspiration de l'état-major contre l'officier.
Le commandant Henry, pourtant adjoint de Picquart, mais jaloux[n 26], mène de son propre chef une opération d'intoxication afin de compromettre son supérieur. Il se livre à diverses malversations (fabrication d'une lettre le désignant comme l'instrument du « syndicat juif » voulant faire évader Dreyfus, truquage du « petit bleu » pour faire croire que Picquart a effacé le nom du réel destinataire, rédaction d'un courrier nommant Dreyfus en toutes lettres).
Parallèlement aux investigations du colonel Picquart, les défenseurs de Dreyfus sont informés de l'identité de l'écriture du « bordereau » avec celle d'Esterhazy en novembre 1897. Mathieu Dreyfus avait fait afficher la reproduction du bordereau, publiée par Le Figaro. Le banquier Jacques de Castro, identifie formellement cette écriture comme celle du commandant Walsin Esterhazy, son débiteur, et prévient Mathieu. Le , les deux pistes se rejoignent, à l'occasion d'une rencontre entre Scheurer-Kestner et Mathieu Dreyfus. Ce dernier obtient enfin la confirmation du fait qu'Esterhazy est bien l'auteur du bordereau. Le , sur ces bases, Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du ministère de la Guerre contre Walsin Esterhazy[132]. La polémique étant publique, l'armée n'a plus d'autre choix que d'ouvrir une enquête. Fin 1897, Picquart, revenu à Paris, fait connaître publiquement ses doutes sur la culpabilité de Dreyfus, du fait de ses découvertes. La collusion destinée à éliminer Picquart semble avoir échoué[133]. La contestation est très forte et vire à l'affrontement. Afin de discréditer Picquart, Esterhazy envoie sans effet des lettres de plainte au Président de la République[134].

Le mouvement dit dreyfusard[n 27], animé par Bernard Lazare, Mathieu Dreyfus, Joseph Reinach et Auguste Scheurer-Kestner s'élargit[137]. Émile Zola, informé mi- par Scheurer-Kestner du dossier, est convaincu de l'innocence de Dreyfus et s'engage officiellement[n 28]. Le , le romancier publie M. Scheurer-Kestner dans Le Figaro, premier article d'une série qui en compte trois[n 29]. Devant les menaces de désabonnements massifs de ses lecteurs, le directeur du journal cesse de soutenir Zola[138]. De proche en proche, fin novembre-début , les écrivains Octave Mirbeau, dont le premier article paraît trois jours après celui de Zola[139], et Anatole France, l'universitaire Lucien Lévy-Bruhl, le bibliothécaire de l'École normale supérieure Lucien Herr, qui convainc Léon Blum et Jean Jaurès, les auteurs de La Revue blanche[n 30], dont Lazare connaît bien le directeur Thadée Natanson, les frères Clemenceau Albert et Georges s'investissent dans le combat pour la révision du procès. Blum tente fin novembre de faire signer à son ami Maurice Barrès une pétition demandant la révision du procès, mais ce dernier refuse, rompt avec Zola et Blum début décembre, et commence à populariser le terme d' « intellectuels »[n 31]. Cette première rupture est le prélude à une division des élites cultivées, après le .
Si l'affaire Dreyfus occupe de plus en plus les discussions, le monde politique ne le reconnaît toujours pas, et le président du Conseil Jules Méline déclare en ouverture de séance de l'Assemblée nationale, le : « Il n'y a pas d'affaire Dreyfus. Il n'y a pas en ce moment et il ne peut pas y avoir d'affaire Dreyfus. »[141]
Procès et acquittement du commandant Esterhazy

Le général de Pellieux est chargé d'effectuer une enquête. Celle-ci tourne court, l'enquêteur étant adroitement manipulé par l'état-major. Le vrai coupable, lui dit-on, est le lieutenant-colonel Picquart[142]. L'enquête s'achemine vers un non-lieu, quand l'ex-maîtresse d'Esterhazy, Mme de Boulancy, fait publier dans Le Figaro des lettres dans lesquelles il exprimait violemment, une dizaine d'années plus tôt, toute sa haine de la France et son mépris de l'Armée française. La presse militariste vole au secours du traître au travers d'une campagne antisémite sans précédent. La presse dreyfusarde réplique, forte des nouveaux éléments en sa possession. Georges Clemenceau, dans le journal L'Aurore, se demande :
« Qui protège le commandant Esterhazy ? La loi s'arrête, impuissante devant cet aspirant prussien déguisé en officier français. Pourquoi ? Qui donc tremble devant Esterhazy ? Quel pouvoir occulte, quelles raisons inavouables s'opposent à l'action de la justice ? Qui lui barre le chemin ? Pourquoi Esterhazy, personnage dépravé à la moralité plus que douteuse, est-il protégé alors que tout l'accuse ? Pourquoi un honnête soldat comme le lieutenant-colonel Picquart est-il discrédité, accablé, déshonoré ? S'il le faut nous le dirons ! »

Bien que protégé par l'état-major et donc par le gouvernement, Esterhazy est obligé d'avouer la paternité des lettres francophobes publiées par Le Figaro. Ceci décide le bureau de l'état-major à agir : une solution pour faire cesser les questions, les doutes et les débuts de demande de justification doit être trouvée. L'idée est d'exiger d'Esterhazy qu'il demande lui-même à passer en jugement et être acquitté afin de faire cesser les bruits et de permettre le retour de l'ordre. C'est donc pour le disculper définitivement, selon la vieille règle « Res judicata pro veritate habetur »[n 32], qu'Esterhazy est présenté le devant un Conseil de guerre. Le huis clos « retardé »[n 33] est prononcé. Esterhazy est prévenu des sujets du lendemain avec des indications sur la ligne de défense à tenir. Le procès est peu régulier : les constitutions de parties civiles de Mathieu et Lucie Dreyfus[n 34] leur sont refusées, les trois experts en écritures ne reconnaissent pas l'écriture d'Esterhazy dans le bordereau et concluent à la contrefaçon[143]. L'accusé lui-même est applaudi, les témoins à charge, hués et conspués, Pellieux intervenant pour défendre l'État-Major sans qualité légale[144]. Le véritable accusé est le colonel Picquart, sali par tous les protagonistes militaires de l'Affaire[145]. Esterhazy est acquitté à l'unanimité dès le lendemain, après trois minutes de délibéré[146]. Sous les vivats, il a du mal à se frayer un chemin vers la sortie où l'attendent 1 500 personnes.

(Le Pèlerin, ).
Par erreur, un innocent a été condamné, mais par ordre, le coupable est acquitté. Pour beaucoup de républicains modérés, c'est une atteinte insupportable aux valeurs fondamentales qu'ils défendent. L'acquittement d'Esterhazy amène donc un changement de la stratégie dreyfusarde. Au libéralisme respectueux de Scheurer-Kestner et Reinach, succède une action plus combative et contestataire[147]. En réaction, d'importantes et violentes émeutes antidreyfusardes et antisémites ont lieu dans toute la France. On attente aux biens et aux personnes.
Fort de sa victoire, l'état-major arrête le lieutenant-colonel Picquart sous l'accusation de violation du secret professionnel, à la suite de la divulgation de son enquête à son avocat qui l'aurait révélée au sénateur Scheurer-Kestner. Le colonel, bien qu'il soit mis aux arrêts au fort du Mont-Valérien, n'abdique pas et s'engage de plus en plus dans l'Affaire. À Mathieu qui le remercie, il réplique qu'il ne « fait que son devoir »[146]. Le commandant Esterhazy est mis rapidement à la réforme, et devant les risques qui pèsent sur sa personne, s'exile en Angleterre où il terminera ses jours confortablement dans les années 1920[148]. Il aura bénéficié lors de « L'Affaire » de l'appui des hautes sphères de l'Armée, qu'explique le désir de l'état-major d'étouffer toute velléité de remise en cause du verdict du Conseil de guerre qui avait condamné le capitaine Dreyfus en 1894.
L'affaire explose en 1898
« J'accuse… ! » : l'affaire Dreyfus devient l'Affaire

Zola donne le une nouvelle dimension à l'affaire Dreyfus, qui devient l'Affaire. Premier grand intellectuel dreyfusard, il est alors au sommet de sa gloire : les vingt volumes des Rougon-Macquart ont été diffusés dans des dizaines de pays. C'est une sommité du monde littéraire, et il en a pleinement conscience. Au général de Pellieux, il affirme pendant son procès :
« Je demande au général de Pellieux s'il n'y a pas différentes façons de servir la France ? On peut la servir par l'épée ou par la plume. M. le général de Pellieux a sans doute gagné de grandes victoires ! J'ai gagné les miennes. Par mes œuvres, la langue française a été portée dans le monde entier. J'ai mes victoires ! Je lègue à la postérité le nom du général de Pellieux et celui d'Émile Zola : elle choisira[149] ! »
Scandalisé par l'acquittement d'Esterhazy, Zola décide de frapper un coup. Il publie le surlendemain, en première page de L'Aurore, un article de 4 500 mots sur six colonnes à la une, en forme de lettre ouverte au président Félix Faure. Ernest Vaughan, directeur de la toute jeune Aurore, trouve le titre : « J'accuse… ! ». Vendu habituellement à trente mille exemplaires, le journal diffuse ce jour-là près de trois cent mille copies. Cet article fait l'effet d'une bombe. Le texte est une attaque directe, explicite et nominative. Tous ceux qui ont comploté contre Dreyfus sont dénoncés, y compris le ministre de la Guerre, l'état-major. L'article comporte de nombreuses erreurs, majorant ou minorant les rôles de tel ou tel acteur[n 35], mais Zola n'a pas prétendu faire œuvre d'historien[150].
« J'accuse… ! » apporte pour la première fois la réunion de toutes les données existantes sur l'Affaire[151]. Le but de Zola est de s'exposer volontairement afin de forcer les autorités à le traduire en justice. Son procès servirait d'occasion pour un nouvel examen public des cas Dreyfus et Esterhazy. Il va ici à l'encontre de la stratégie de Scheurer-Kestner et Lazare, qui prônaient la patience et la réflexion[152]. Devant le succès national et international de ce coup d'éclat, le procès est inévitable. À partir de ce moment critique, l'Affaire suit deux voies parallèles. D'une part, l'État utilise son appareil pour imposer la limitation du procès à une simple affaire de diffamation, afin de le dissocier des cas Dreyfus et Esterhazy, déjà jugés. D'autre part, les conflits d'opinion tentent de peser sur les juges ou le gouvernement, pour obtenir les uns la révision et les autres la condamnation de Zola. Mais l'objectif du romancier est atteint : l'ouverture d'un débat public aux assises.
Le , Le Temps publie une pétition réclamant la révision du procès[153]. Y figurent les noms d'Émile Zola, Anatole France, le directeur de l'Institut Pasteur Émile Duclaux, Daniel Halévy, Fernand Gregh, Félix Fénéon, Marcel Proust, Lucien Herr, Charles Andler, Victor Bérard, François Simiand, Georges Sorel, puis le peintre Claude Monet, l'écrivain Jules Renard, le sociologue Émile Durkheim, l'historien Gabriel Monod, etc.
Le , à la suite d'une intervention à la Chambre des députés de l'élu catholique Albert de Mun contre Zola, celle-ci décide les poursuites par 312 voix contre 122[154]. Dans L'Aurore du , Clemenceau, au nom d'une « pacifique révolte de l'esprit français », reprend positivement le terme d'« intellectuels ». Le , Barrès fustige ceux-ci dans Le Journal. L'anti-intellectualisme devient un thème majeur des intellectuels de droite, qui reprochent aux dreyfusards de réfléchir au-delà des intérêts de la nation, argument qui se retrouve tout au long des années qui suivent, et qui constitue le fond du débat public : priorité accordée à la justice et vérité ou à la défense de la nation, préservation sociale ou raison supérieure de l'État[155]… Cette mobilisation des intellectuels ne se double pas dans un premier temps de celle de la gauche politique : le , les députés socialistes prennent leurs distances face aux « deux factions bourgeoises rivales ».
Les procès Zola

Zola aux outrages, huile sur toile peinte par Henry de Groux, 1898.
Le général Billot, ministre de la Guerre, porte plainte contre Zola et Alexandre Perrenx, le gérant de L'Aurore, qui passent devant les Assises de la Seine du 7 février au . La diffamation envers une autorité publique est alors passible des Assises, alors que l'injure publique proférée par la presse nationaliste et antisémite n'amène que très peu de poursuites, et surtout quasiment aucune condamnation. Le ministre ne retient que trois passages de l'article[156], soit dix-huit lignes sur plusieurs centaines. Il est reproché à Zola d'avoir écrit que le Conseil de guerre avait commis une « illégalité […] par ordre »[157]. Le procès s'ouvre dans une ambiance de grande violence : Zola récolte des insultes (« italianasse »[158], émigré, apatride[159]), mais aussi d'importants soutiens et de félicitations[n 36].

Dessin de Paul Renouard à la une du magazine The Graphic, .

Fernand Labori, l'avocat de Zola, fait citer environ deux cents témoins. La réalité de l'Affaire Dreyfus, inconnue du grand public, est diffusée dans la presse. Plusieurs journaux, dont Le Siècle d'Yves Guyot, autre militant dreyfusard, et L'Aurore, publient les notes sténographiques in extenso des débats au jour le jour, ce qui édifie la population. Celles-ci constituent pour les dreyfusards un outil primordial pour les débats postérieurs. Cependant, les nationalistes, derrière Henri Rochefort, sont alors les plus visibles et organisent des émeutes, forçant le préfet de police à intervenir afin de protéger les sorties de Zola[160], à chaque audience[161].
Ce procès est aussi le lieu d'une véritable bataille juridique, dans laquelle les droits de la défense sont sans cesse bafoués[162]. De nombreux observateurs prennent conscience de la collusion entre le monde politique et les militaires. À l'évidence, la Cour a reçu des instructions pour que la substance même de l'erreur judiciaire ne soit pas évoquée. Le président Delegorgue, prétextant l'allongement de durée des audiences, jongle sans cesse avec le droit pour que le procès ne traite que de la diffamation reprochée à Zola. Sa phrase « la question ne sera pas posée », répétée des dizaines de fois[163], devient célèbre[n 37].
Zola est condamné à un an de prison et à 3 000 francs d'amende, la peine maximale. Octave Mirbeau paie de sa poche les 7 525 francs, représentant le montant de l'amende et des frais de justice, le [164]. La dureté du verdict est imputable à l'atmosphère de violence entourant le procès :
« La surexcitation de l'auditoire, l'exaspération de la foule massée devant le palais de Justice étaient si violentes qu'on pouvait redouter les excès les plus graves si le jury avait acquitté M. Zola[165]. »
Cependant, le procès Zola est plutôt une victoire pour les dreyfusards[166]. En effet, l'Affaire et ses contradictions ont pu être largement évoquées tout au long du procès, en particulier par des militaires. De plus, la violence des attaques contre Zola, et l'injustice de sa condamnation renforcent l'engagement des dreyfusards : Stéphane Mallarmé se déclare « pénétré par la sublimité de [l']Acte [de Zola] »[167] et Jules Renard écrit dans son journal :
« À partir de ce soir, je tiens à la République, qui m'inspire un respect, une tendresse que je ne me connaissais pas. Je déclare que le mot Justice est le plus beau de la langue des hommes, et qu'il faut pleurer si les hommes ne le comprennent plus[168]. »
Le sénateur Ludovic Trarieux et le juriste catholique Paul Viollet fondent la Ligue pour la défense des droits de l'homme. Plus encore que l'affaire Dreyfus, l'affaire Zola opère un regroupement des forces intellectuelles en deux camps opposés.
Le , une demande de pourvoi en cassation reçoit une réponse favorable. Il s'agit de la première intervention de la Cour dans cette affaire judiciaire. La plainte aurait en effet dû être portée par le Conseil de guerre et non par le ministre. Le procureur général Manau est favorable à la révision du procès Dreyfus et s'oppose fermement aux antisémites. Les juges du Conseil de guerre, mis en cause par Zola, portent plainte pour diffamation. L'affaire est déférée devant les assises de Seine-et-Oise à Versailles où le public passe pour être plus favorable à l'Armée, plus nationaliste. Le , dès la première audience, Me Labori se pourvoit en cassation en raison du changement de juridiction. Le procès est ajourné et les débats sont repoussés au . Labori conseille à Zola de quitter la France pour l'Angleterre avant la fin du procès, ce que fait l'écrivain, en partant seul pour un exil d'un an en Angleterre. Les accusés sont de nouveau condamnés. Quant au colonel Picquart, il se retrouve à nouveau en prison.
Henry démasqué, l'Affaire rebondit
L'acquittement d'Esterhazy, les condamnations d'Émile Zola et de Georges Picquart, et la présence continue d'un innocent au bagne, ont un retentissement national et international[169] considérable. La France expose un arbitraire étatique contredisant les principes républicains fondateurs. L'antisémitisme fait des progrès considérables, et les émeutes sont courantes pendant toute l'année 1898. Cependant, les hommes politiques en restent encore au déni de l'Affaire. En avril et , ils sont surtout préoccupés par les élections législatives, après lesquelles Jaurès perd son siège de député de Carmaux[170]. La majorité reste « modérée », et un groupe parlementaire antisémite apparaît à la Chambre. Cependant, la cause dreyfusarde est relancée.

En effet, Godefroy Cavaignac, nouveau ministre de la Guerre et anti-révisionniste farouche, veut démontrer définitivement la culpabilité de Dreyfus, en « tordant le cou » au passage à Esterhazy, qu'il tient pour « un mythomane et un maître chanteur »[171]. Il est absolument convaincu de la culpabilité de Dreyfus, renforcé dans cette idée par la légende des aveux, après avoir rencontré le principal témoin, le capitaine Lebrun-Renault[172]. Cavaignac a l'honnêteté d'un doctrinaire intransigeant[173], mais ne connaît absolument pas les dessous de l'Affaire, que l'État-Major s'est gardé de lui enseigner. Il a la surprise d'apprendre que l'ensemble des pièces sur lesquelles l'accusation se basait n'avaient pas été expertisées, Boisdeffre ayant « une confiance absolue » en Henry. Il décide d'enquêter lui-même, dans son bureau avec ses adjoints, et rapatrie le dossier secret qui compte alors 365 pièces[174].
Le , lors d'une interpellation à la Chambre, Cavaignac fait état de trois pièces « accablantes, entre mille », dont deux n'ont aucun rapport avec l'Affaire, et l'autre est le faux d'Henry[175]. Le discours de Cavaignac est efficace : les députés l'ovationnent et votent l'affichage du discours avec la reproduction des trois preuves dans les 36 000 communes de France à 572 voix[176]. Les antidreyfusards triomphent, mais Cavaignac a reconnu implicitement que la défense de Dreyfus n'avait pas eu accès à toutes les preuves : la demande en annulation formulée par Lucie Dreyfus devient recevable. Le lendemain, le colonel Picquart déclare dans Le Temps au président du Conseil : « Je suis en état d'établir devant toute juridiction compétente que les deux pièces portant la date de 1894 ne sauraient s'appliquer à Dreyfus et que celle qui portait la date de 1896 avait tous les caractères d'un faux. », ce qui lui vaut onze mois de prison.

Le au soir, le capitaine Cuignet, attaché au cabinet de Cavaignac, qui travaille à la lumière d'une lampe, observe que la couleur du léger quadrillage du papier de l'entête et du bas de page ne correspondent pas à la partie centrale. Cavaignac tente encore de trouver des raisons logiques à la culpabilité et la condamnation de Dreyfus[177] mais ne tait pas cette découverte[178]. Un conseil d'enquête est formé pour enquêter sur Esterhazy, devant lequel celui-ci panique et avoue ses rapports secrets avec le commandant du Paty de Clam. La collusion entre l'État-Major et le traître est révélée. Le , Cavaignac se résigne à demander des explications au colonel Henry, en présence de Boisdeffre et Gonse. Après une heure d'interrogatoire mené par le ministre lui-même, Henry s'effondre et fait des aveux complets[179]. Il est placé aux arrêts de forteresse au Mont-Valérien et se suicide[n 38],[181] le lendemain en se tranchant la gorge avec un rasoir. La demande de révision déposée par Lucie Dreyfus ne peut plus être repoussée. Pourtant, Cavaignac affirme : « moins que jamais ! »[182], mais le président du Conseil, Henri Brisson, le force à démissionner. Malgré son rôle, apparemment totalement involontaire, dans la révision du procès de 1894, il reste un antidreyfusard convaincu et fera une intervention méprisante et blessante envers Dreyfus au procès de Rennes[183].
Les antirévisionnistes ne se considèrent pas comme battus. Le , Charles Maurras publie un éloge d'Henry dans La Gazette de France, qu'il qualifie de « serviteur héroïque des grands intérêts de l'État »[184]. La Libre Parole, journal antisémite de Drumont, propage la notion de « faux patriotique ». Le même journal lance en décembre une souscription au profit de sa veuve, afin d'ériger un monument à la gloire d'Henry, d'où le nom qui lui est donné de Monument Henry[185]. Chaque donation est accompagnée de remarques lapidaires sur Dreyfus et les dreyfusards, souvent injurieuses. 14 000 souscripteurs[186], dont 53 députés, envoient 131 000 francs[187]. Le , le président du Conseil, Brisson, incite Mathieu Dreyfus à déposer une demande en révision du Conseil de guerre de 1894. Le gouvernement transfère le dossier à la Cour de cassation, pour avis sur les quatre ans de procédures passées.
La France est réellement divisée en deux, mais aucune généralisation n'est possible : la communauté juive s'engage peu, les intellectuels ne sont pas tous dreyfusards[n 39], les protestants sont partagés, des marxistes refusent de soutenir Dreyfus[188]. Le clivage transcende les religions et milieux sociaux, comme l'illustre la célèbre caricature de Caran d'Ache Un dîner en famille.
-
Caricature dreyfusarde d'Henri-Gabriel Ibels moquant le projet du « monument Henry » (Le Sifflet, 1898). -
Un dîner en famille, dessin de Caran d'Ache dans le Figaro du .
Crise et recomposition du paysage politique

Henry est mort, Boisdeffre a démissionné, Gonse n'a plus aucune autorité et du Paty a été très gravement compromis par Esterhazy : pour les conjurés, c'est la débâcle[190]. Le gouvernement est désormais pris entre deux feux : la loi et le droit contre la pression nationaliste de la rue et du commandement supérieur qui se reprend. Cavaignac, démis pour avoir continué à répandre sa vision antidreyfusarde de l'Affaire, se pose en chef de file antirévisionniste. Le général Zurlinden qui lui succède, influencé par l'état-major, rend un avis négatif à la révision le 10 septembre, conforté par la presse extrémiste pour laquelle « la révision, c'est la guerre ». L'obstination du gouvernement, qui vote le recours à la Cour de cassation le , amène la démission de Zurlinden, remplacé aussitôt par le général Chanoine[191]. Celui-ci, lors d'une interpellation à la Chambre, donne sa démission, la confiance étant refusée à Brisson, contraint lui aussi à la démission. L'instabilité ministérielle entraîne une certaine instabilité gouvernementale.

Le , le progressiste[n 40] Charles Dupuy est nommé à la place de Brisson. En 1894, il avait couvert les agissements du général Mercier aux débuts de l'affaire Dreyfus[192] ; quatre ans plus tard, il annonce qu'il suivra les arrêts de la Cour de cassation, barrant la route à ceux qui veulent étouffer la révision et dessaisir la Cour[193]. Le 5 décembre, à la faveur d'un débat à la Chambre sur la transmission du « dossier secret » à la Cour de cassation, la tension monte encore d'un cran. Les injures, invectives et autres violences nationalistes font place aux menaces de soulèvement. Paul Déroulède déclare : « S'il faut faire la guerre civile, nous la ferons. »[194]
Une nouvelle crise survient au sein même de la Cour de cassation, lorsque Quesnay de Beaurepaire, président de la chambre civile, accuse la chambre criminelle de dreyfusisme par voie de presse. Il démissionne le en héros de la cause nationaliste. Cette crise aboutit au dessaisissement de la chambre criminelle au profit des chambres réunies. C'est le blocage de la révision[195].
En 1899, l'Affaire occupe de plus en plus la scène politique. Le , le président de la République Félix Faure meurt[196]. Émile Loubet est élu, une avancée pour la cause de la révision, le président précédent en étant un farouche opposant. Le 23 février, à la faveur des funérailles de Félix Faure, Déroulède tente un coup de force sur l'Élysée. C'est un échec, les militaires ne se ralliant pas. Le , Loubet est agressé sur le champ de course de Longchamp. Ces provocations, auxquelles s'ajoutent les manifestations permanentes de l'extrême-droite, bien qu'elles ne mettent jamais réellement la République en danger, créent un sursaut républicain qui conduit à la formation d'un « gouvernement de défense républicaine » autour de Waldeck-Rousseau le . Les républicains « progressistes » antidreyfusards, tel Méline, sont rejetés à droite. L'affaire Dreyfus a conduit à une recomposition claire du paysage politique français.
-
Chef de la Ligue des patriotes, Paul Déroulède tente un coup d'État le en cherchant à entraîner les troupes du général Roget vers le palais de l'Élysée
(Le Petit Journal, 1899).
La cassation du jugement de 1894

Le , après un vote du Cabinet, le garde des Sceaux saisit la Cour de cassation. Le 29 octobre, à l'issue de la communication du rapport du rapporteur Alphonse Bard, la chambre criminelle de la Cour déclare « la demande recevable et dit qu'il sera procédé par elle à une instruction supplémentaire »[197].
La Cour de cassation examine l'affaire dans un contexte de campagnes de presse contre la chambre criminelle, les magistrats étant constamment traînés dans la boue dans les journaux nationalistes depuis le scandale de Panama[198]. Le rapporteur Louis Loew préside. Il est l'objet d'une très violente campagne d'injures antisémites, alors qu'il est protestant alsacien, accusé d'être un déserteur, un vendu aux Prussiens. Malgré les silences complaisants de Mercier, Billot, Zurlinden et Roget qui se retranchent derrière l'autorité de la chose jugée et le secret d'État, la compréhension de l'Affaire progresse. Cavaignac fait une déposition de deux jours, mais ne parvient pas à démontrer la culpabilité de Dreyfus. Au contraire, il le disculpe involontairement par une démonstration de la datation exacte du bordereau ()[128].
Puis Picquart démontre l'ensemble des rouages de l'erreur puis de la conspiration[199]. Dans une décision du , Picquart est écarté du Conseil de guerre par la chambre criminelle[200]. C'est un nouvel obstacle aux volontés de l'état-major. Une nouvelle campagne de presse furieusement antisémite éclate à l'occasion de cet événement, alors que L'Aurore du titre « Victoire » dans les mêmes caractères que « J'accuse… ! »[201]. Le travail d'enquête est tout de même repris par la chambre criminelle[202]. Le « dossier secret » est analysé à partir du , et la chambre demande la communication du dossier diplomatique, ce qui est accordé.
Le , la chambre criminelle rend son rapport en mettant en exergue deux faits majeurs : il est certain qu'Esterhazy a utilisé le même papier pelure que le bordereau[n 41] et le dossier secret est totalement vide. Ces deux faits majeurs anéantissent toutes les procédures contre Alfred Dreyfus à eux seuls. Mais parallèlement, faisant suite à l'incident provoqué par Quesnay de Beaurepaire, le président Mazeau instruit une enquête sur la chambre criminelle, qui aboutit au dessaisissement de celle-ci « afin de ne pas la laisser porter seule toute la responsabilité de la sentence définitive », ce qui prive la chambre criminelle de la poursuite des actions qui découleraient de son rapport.
Le , Waldeck-Rousseau s'exprime au Sénat sur le fond et dénonce la « conspiration morale » au sein du gouvernement et dans la rue. La révision n'est plus évitable. Le , le nouveau président de la chambre civile de la Cour de cassation, Alexis Ballot-Beaupré, est nommé rapporteur pour l'examen de la demande de révision. Il aborde le dossier en juriste et décide d'un supplément d'enquête. Dix témoins complémentaires sont interrogés, lesquels affaiblissent encore la version de l'état-major. Dans le débat final et en modèle d'objectivité, le président Ballot-Beaupré démontre l'inanité du bordereau, la seule charge contre Dreyfus. Le procureur Manau abonde dans le sens du président. Me Mornard qui représente Lucie Dreyfus plaide sans aucune difficulté ni opposition du parquet[203].

Le , les chambres réunies de la Cour de cassation cassent le jugement de 1894 en audience solennelle[204]. L'affaire est renvoyée devant le Conseil de guerre de Rennes. Les conséquences sont immédiates : Zola, exilé en Angleterre, revient en France, Picquart est libéré, Mercier est accusé de communication illégale de pièces. Avec cet arrêt, la Cour de cassation s'impose comme une véritable autorité, capable de tenir tête à l'armée et au pouvoir politique[205]. Pour de nombreux dreyfusards, cette décision de justice est l'antichambre de l'acquittement du capitaine ; ils oublient de considérer que c'est de nouveau l'armée qui le juge. La Cour, en cassant avec renvoi, a cru en l'autonomie juridique du Conseil de guerre sans prendre en compte les lois de l'esprit de corps[Information douteuse][206].
Le procès de Rennes 1899
Déroulement du procès

Le prisonnier n'est en rien informé d'événements qui se déroulent à des milliers de kilomètres de lui : ni des complots ourdis pour qu'il ne puisse jamais revenir, ni de l'engagement d'innombrables hommes et femmes à sa cause. L'administration pénitentiaire filtre les informations qu'elle juge confidentielles. À la fin de l'année 1898, il apprend avec stupéfaction la dimension réelle de l'Affaire, dont il ne sait rien : l'accusation de son frère contre Esterhazy, l'acquittement du traître, l'aveu et le suicide d'Henry, ceci à la lecture du dossier d'enquêtes de la Cour de cassation qu'il reçoit deux mois après sa publication[207]. Le , Alfred Dreyfus est prévenu de la décision de cassation du jugement de 1894. Le 9 juin, il quitte l'île du Diable, cap vers la France, enfermé dans une cabine comme un coupable qu'il n'est pourtant plus. Il débarque le 30 juin à Port-Haliguen, sur la presqu'île de Quiberon, dans le plus grand secret, « par une rentrée clandestine et nocturne »[208]. Après cinq années de martyre, il retrouve son sol natal, mais il est immédiatement enfermé dès le 1er juillet à la prison militaire de Rennes. Il est déféré le 7 août devant le Conseil de guerre de la capitale bretonne, dans le lycée de Rennes (aujourd'hui lycée Émile-Zola).

Le général Mercier, champion des antidreyfusards, intervient constamment dans la presse, pour réaffirmer l'exactitude du premier jugement : Dreyfus est bien le coupable. Or immédiatement se font jour des dissensions dans la défense de Dreyfus : ses deux avocats suivent des stratégies opposées. Me Demange souhaite se tenir sur la défensive et obtenir simplement l'acquittement de Dreyfus. Me Labori, brillant avocat de 35 ans, offensif, cherche à frapper plus haut ; il veut la défaite de l'état-major, son humiliation publique. Mathieu Dreyfus a imaginé une complémentarité entre les deux avocats. Le déroulement du procès montre que c'est une erreur, dont l'accusation va se servir devant une défense affaiblie.

Le procès s'ouvre le dans un climat de tension extrême. Rennes est en état de siège[209]. Les juges du Conseil de guerre sont sous pression. Esterhazy, qui a avoué la paternité du bordereau, en exil en Angleterre, et du Paty, se sont fait excuser. Dreyfus apparaît, l'émotion est forte. Son apparence physique bouleverse ses partisans et certains de ses adversaires[n 42]. Malgré sa condition physique dégradée, il a une maîtrise complète du dossier, acquise en seulement quelques semaines[210]. Tout l'état-major témoigne contre Dreyfus sans apporter aucune preuve.
On ne fait que s'entêter et on considère comme nuls les aveux d'Henry et d'Esterhazy. Le procès tend même à déraper, dans la mesure où les décisions de la Cour de cassation ne sont pas prises en compte. On discute notamment du bordereau, alors que la preuve a été apportée de la culpabilité d'Esterhazy. Pourtant, Mercier se fait huer à la sortie de l'audience. La presse nationaliste et antidreyfusarde se perd en conjectures sur son silence à propos de la « preuve décisive » dont il n'a cessé de faire état avant le procès (un prétendu bordereau annoté par le Kaiser, dont personne ne verra jamais aucune trace).

Le 14 août, Me Labori est victime d'un attentat sur son parcours vers le tribunal. Un antidreyfusard extrémiste, qui s'enfuit et ne sera jamais retrouvé, lui tire dans le dos. L'avocat est donc écarté des débats pendant plus d'une semaine, au moment décisif de l'interrogatoire des témoins. Le 22 août, son état s'étant amélioré, il est de retour. Les incidents entre les deux avocats de Dreyfus se multiplient, Labori reprochant à Demange sa trop grande prudence. Le gouvernement, devant le raidissement militaire du procès, peut agir encore de deux manières pour infléchir les événements : en faisant appel à un témoignage des Allemands, ou par l'abandon de l'accusation[211].

Mais ces tractations en arrière-plan sont sans résultats. L'ambassade d'Allemagne adresse un refus poli au gouvernement. Le ministre de la guerre, le général Gaston de Galliffet, fait envoyer un mot respectueux au commandant Louis Carrière, commissaire du gouvernement. Il lui demande de rester dans l'esprit de l'arrêt de révision de la Cour de cassation. L'officier feint de ne pas comprendre l'allusion et, aidé de l'avocat nationaliste Auffray, âme véritable de l'accusation, il prononce un réquisitoire contre Dreyfus. Du côté de la défense, il faut prendre une décision, car l'issue du procès s'annonce mal, malgré l'évidence de l'absence de charges contre l'accusé. Sur pression du président du Conseil Waldeck-Rousseau, aidé de Jaurès et Zola, Me Labori est convaincu de renoncer à sa plaidoirie pour ne pas heurter l'armée. On décide de jouer la conciliation en échange de l'acquittement que semble promettre le gouvernement. Mais c'est un nouveau jeu de dupes[212].

Me Demange, seul et sans illusions, assure la défense de Dreyfus, dans une atmosphère tendue. À Paris, les agitateurs antisémites et nationalistes d'Auteuil sont arrêtés. Jules Guérin, président de la Ligue antisémitique et directeur du journal hebdomadaire L'Antijuif, et ceux qui se sont retranchés avec lui au « Fort Chabrol » sont assaillis par la police. Accusés de complot, plusieurs meneurs et militants antidreyfusards comparaissent devant la Haute Cour.
Nouvelle condamnation
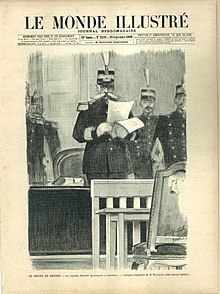
Le , la Cour rend son verdict : Dreyfus est reconnu coupable de trahison mais « avec circonstances atténuantes » (par 5 voix contre 2), condamné à dix ans de réclusion et à une nouvelle dégradation. Contrairement aux apparences, ce verdict est au bord de l'acquittement à une voix près. Le code de justice militaire prévoyait en effet le principe de minorité de faveur à trois voix contre quatre[213]. Ce verdict absurde[214] a les apparences d'un aveu coupable des membres du Conseil de guerre. Ils semblent ne pas vouloir renier la décision de 1894, et savent bien que le dossier ne repose que sur du vent. Mais on peut aussi interpréter cette décision comme un verdict habile, car les juges, tout en ménageant leurs pairs ainsi que les modérés angoissés par les risques de guerre civile, reconnaissent implicitement l'innocence de Dreyfus : peut-on trahir avec des circonstances atténuantes[215] ?

Gravure de Paul Renouard, 1899.
Le lendemain du verdict, Alfred Dreyfus, après avoir hésité, dépose un pourvoi en révision. Waldeck-Rousseau, dans une position difficile, aborde pour la première fois la grâce. Pour Dreyfus, c'est accepter la culpabilité. Mais à bout de force, éloigné des siens depuis trop longtemps, il accepte. Le décret est signé le 19 septembre et il est libéré le . Nombreux sont les dreyfusards frustrés par cette solution. L'opinion publique accueille cette conclusion de manière indifférente. La France aspire à la paix civile et à la concorde à la veille de l'exposition universelle de 1900[réf. nécessaire] et avant le grand combat que la République s'apprête à mener pour la liberté des associations.
C'est dans cet esprit que le , Waldeck-Rousseau dépose une loi d'amnistie couvrant « tous les faits criminels ou délictueux connexes à l'Affaire Dreyfus ou ayant été compris dans une poursuite relative à l'un de ces faits ». Les dreyfusards s'insurgent, ils ne peuvent accepter que les véritables coupables soient absous de leurs crimes d'État, alors même que Zola et Picquart doivent toujours passer en jugement. Malgré d'immenses protestations, la loi est adoptée. Il n'existe alors plus aucun recours possible pour obtenir que l'innocence de Dreyfus soit reconnue ; il faut désormais trouver un fait nouveau pouvant entraîner la révision.
Réactions

Une « allégorie de la Mort, voilée comme l'était l'informatrice mystérieuse et imaginaire rencontrée par Esterhazy, joue du violon pour faire danser, pendus à des gibets, les corps des chefs de l'État-major, aux visages grimaçants et expressifs – Du Paty de Clam, Mercier et Boisdeffre », responsables de la condamnation de Dreyfus[216].
Caricature dreyfusarde d'Ibels, Paris, musée Carnavalet.
Les réactions en France sont vives, faites de « stupeur et de tristesse » dans le camp révisionniste[217]. Pourtant d'autres réactions tendent à montrer que le « verdict d'apaisement » rendu par les juges est compris et accepté par la population. Les Républicains cherchent avant tout la paix sociale, pour tourner la page de cette longue affaire extrêmement polémique. Aussi, les manifestations sont très peu nombreuses en province, alors que l'agitation persiste quelque peu à Paris[218]. Dans le monde militaire, l'apaisement est aussi de rigueur. Deux des sept juges ont voté l'acquittement[n 43]. Ils ont refusé de céder à l'ordre militaire implicite. Ceci est aussi clairement perçu. Dans une apostrophe à l'armée, Galliffet annonce : « L'incident est clos. »
Des manifestations anti-françaises ont lieu dans vingt capitales étrangères ; la presse est scandalisée[220]. Les réactions sont de deux ordres. Les Anglo-saxons, légalistes, se focalisent sur l'affaire d'espionnage et contestent assez violemment ce verdict de culpabilité sans arguments positifs pour son édification. À ce titre, le rapport adressé le par le Lord Chief Justice d'Angleterre, Lord Russell of Killowen, à la reine Victoria, est significatif de la répercussion mondiale de l'Affaire. Le magistrat britannique, qui s'est rendu en observateur à Rennes, critique les failles du conseil de guerre :
« Les juges militaires “n'étaient pas familiers de la loi” […]. Ils manquaient de l'expérience et de l'aptitude qui permettent de voir la preuve derrière le témoignage. […] Ils ont agi en fonction de ce qu'ils considéraient comme l'honneur de l'armée. […] ils ont accordé trop d'importance aux fragiles allégations qui ont seules été présentées contre l'accusé. […] Il paraît certain que si le procès de révision avait eu lieu devant la Cour de cassation, Dreyfus serait maintenant un homme libre. »
En Allemagne et en Italie, les deux pays largement mis en cause par les procès contre Dreyfus, c'est le soulagement. Même si l'Empereur d'Allemagne regrette que l'innocence de Dreyfus n'ait pas été reconnue, la normalisation des relations franco-prussiennes qui s'annonce est vue comme une détente bienvenue. Aucune nation n'a intérêt à une tension permanente. La diplomatie des trois puissances, avec l'aide de l'Angleterre, va s'employer à détendre une atmosphère qui ne se dégradera de nouveau qu'à la veille de la Première Guerre mondiale.
Le philosophe juif lituanien Emmanuel Levinas citera plus tard son grand-père, qui répétait en se référant à l'affaire Dreyfus : « Un pays qui se déchire, qui se divise pour sauver l’honneur d’un petit officier juif, c’est un pays où il faut rapidement aller »[221]. Emmanuel Levinas ajoute que cette affaire a contribué à son établissement ultérieur en France.
Cette conclusion judiciaire a aussi une conséquence malheureuse sur les relations entre la famille Dreyfus et la branche radicale des dreyfusistes. Fernand Labori, Jaurès et Clemenceau, appuyés par le colonel Picquart, reprochent ouvertement à Alfred Dreyfus d'avoir accepté la grâce et d'avoir mollement protesté à la loi d'amnistie. Deux ans après la conclusion provisoire de l'Affaire, leur amitié prenait ainsi fin[222].
La longue marche vers la réhabilitation, 1900-1906

Préférant éviter un troisième procès, le gouvernement a donc décidé de gracier Dreyfus : le président Émile Loubet le signe le décret après de multiples tergiversations. Dreyfus n'est pas pour autant innocenté. Le processus de réhabilitation ne sera achevé que près de sept ans plus tard, sans éclat ni passion.
De nombreux ouvrages paraissent pendant cette période. Jaurès publie Les Preuves en 1898, Reinach fait paraître son Histoire de l'Affaire Dreyfus à partir de 1901, Zola écrit le troisième de ses Quatre évangiles : Vérité, publié après sa mort, en 1903. Même Esterhazy en profite par des confidences et vend plusieurs versions différentes des textes de sa déposition au consul de France[223]. Alfred Dreyfus, quant à lui, publie ses mémoires en 1901[224].
Mort de Zola

Le , Zola, l'initiateur de l'explosion de « l'Affaire » et le plus en vue des intellectuels dreyfusards, meurt asphyxié par la fumée de sa cheminée. Son épouse, Alexandrine, en réchappe de justesse[225]. C'est le choc dans le clan des dreyfusards.
Anatole France, qui a exigé que Dreyfus soit présent aux obsèques, alors que le préfet de police souhaitait son absence « pour éviter les troubles », prononce une célèbre oraison funèbre en faveur de l'auteur de « J'accuse… ! » :
« Devant rappeler la lutte entreprise par Zola pour la justice et la vérité, m'est-il possible de garder le silence sur ces hommes acharnés à la ruine d'un innocent et qui, se sentant perdus s'il était sauvé, l'accablaient avec l'audace désespérée de la peur ?
Comment les écarter de votre vue, alors que je dois vous montrer Zola se dressant, faible et désarmé devant eux ?
Puis-je taire leurs mensonges ?
Ce serait taire sa droiture héroïque.
Puis-je taire leurs crimes ?
Ce serait taire sa vertu.
Puis-je taire les outrages et les calomnies dont ils l'ont poursuivi ?
Ce serait taire sa récompense et ses honneurs.
Puis-je taire leur honte ?
Ce serait taire sa gloire.
Non, je parlerai.
Envions-le : il a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et un grand acte.
Envions-le, sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand.
Il fut un moment de la conscience humaine. »
Semi-réhabilitation
Réhabilitation juridique

|

| |
Le général Louis André et Manuel Baudouin, procureur général, œuvrent à la réhabilitation du capitaine Dreyfus.
| ||
Les élections de 1902 avaient vu la victoire des gauches. C'est Jean Jaurès, réélu, qui relance l'Affaire le alors que la France la pensait enterrée. Dans un discours, Jaurès évoque la longue liste des faux qui parsèment le dossier Dreyfus, et insiste particulièrement sur deux pièces saillantes :
- La lettre de démission du général de Pellieux, rédigée en termes très durs. Juridiquement, elle a les formes d'un aveu de la collusion de l'état-major :
« Dupe de gens sans honneur, ne pouvant plus compter sur la confiance des subordonnés sans laquelle le commandement est impossible, et de mon côté, ne pouvant avoir confiance en ceux de mes chefs qui m'ont fait travailler sur des faux, je demande ma mise à la retraite. »
- Le bordereau prétendument annoté (par l'empereur Guillaume II) auquel le général Mercier avait fait allusion au procès de Rennes, et dont le fait rapporté par la presse aurait influencé les juges du Conseil de guerre[n 44],[226],[227].
Devant ces faits nouveaux, le général André, nouveau ministre de la Guerre, mène une enquête à l'instigation d'Émile Combes, assisté de magistrats. L'enquête est menée par le capitaine Targe, officier d'ordonnance du ministre. À l'occasion de perquisitions à la Section de statistiques, il découvre de très nombreuses pièces dont la majorité sont visiblement fabriquées[228]. En , un rapport est remis au garde des Sceaux par le ministre de la Guerre. C'est l'application des règles lorsque le ministre constate une erreur commise en Conseil de guerre. C'est le début d'une nouvelle révision, dirigée par l'avocat Ludovic Trarieux[229], fondateur de la Ligue des droits de l'homme, avec une enquête minutieuse qui s'étendra sur deux ans.
Les années 1904 et 1905 sont consacrées aux différentes phases judiciaires devant la Cour de cassation. La cour emploie trois moyens (causes) à la révision :
- démonstration de la falsification du télégramme de Panizzardi.
- démonstration du changement de date d'une pièce du procès de 1894 ( changé en ).
- démonstration du fait que Dreyfus n'avait pas fait disparaître les minutes d'attribution de l'artillerie lourde aux armées.
Concernant l'écriture du bordereau, la cour est particulièrement sévère à l'égard de Bertillon qui a « raisonné mal sur des documents faux ». Le rapport[n 45] démontre que l'écriture est bien d'Esterhazy, ce que ce dernier a d'ailleurs avoué entre-temps. Enfin, la Cour démontre par une analyse complète et subtile du bordereau l'inanité de cette construction purement intellectuelle, et une commission de quatre généraux dirigée par un spécialiste de l'artillerie, le général Sebert, affirme « qu'il est fortement improbable qu'un officier d'artillerie ait pu écrire cette missive »[230].

Le , le procureur général Baudouin rend un rapport de 800 pages dans lequel il réclame la cassation sans renvoi et fustige l'armée. Il amorce un dessaisissement de la justice militaire qui ne trouvera sa conclusion qu'en 1982[232]. Il faut attendre le pour que la Cour de cassation, toutes chambres réunies, annule sans renvoi le jugement rendu à Rennes en 1899 et prononce « l'arrêt de réhabilitation du capitaine Dreyfus ». Les antidreyfusards crient à la réhabilitation à la sauvette. Mais le but est évidemment politique : il s'agit d'en finir et de tourner la page définitivement. Rien ne peut entamer la conviction des adversaires de Dreyfus. Cette forme est donc la plus directe et la plus définitive. Ce qui est annulé est non seulement l'arrêt de Rennes, mais toute la chaîne des actes antérieurs, à commencer par l'ordre de mise en jugement donné par le général Saussier en 1894. La Cour s'est focalisée sur les aspects juridiques uniquement et constate que Dreyfus ne doit pas être renvoyé devant un Conseil de guerre pour la simple raison qu'il n'aurait jamais dû y passer, devant l'absence totale de charges :
« Attendu, en dernière analyse, que de l'accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout ; et que l'annulation du jugement du Conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou délit ; dès lors, par application du paragraphe final de l'article 445 aucun renvoi ne doit être prononcé. »
L'injustice militaire

Dreyfus est réintégré dans l'armée, avec le grade de chef d'escadron (commandant), par la loi du . Alors qu'il pouvait légitimement prétendre au grade de lieutenant-colonel[233], ses cinq années de déportation et d'incarcération ne sont pas prises en compte pour la reconstitution de sa carrière. En raison de son âge, cette réintégration incomplète brise son espoir d'atteindre, à terme, le grade d'officier général. Il demande donc à contrecœur sa mise en retraite en . Les magistrats ne pouvaient rien contre cette ultime injustice volontairement commise. Le droit et l'égalité étaient encore une fois bafoués[234]. Dreyfus n'a jamais demandé de dédommagement à l'État, ni de dommages-intérêts à qui que ce soit. La seule chose qui lui importait, c'était la reconnaissance de son innocence[235].
Le , à l'occasion du transfert des cendres d'Émile Zola au Panthéon, Alfred Dreyfus est la cible d'un attentat. Louis Grégori, journaliste d'extrême droite, adjoint de Drumont, tire deux coups de revolver et blesse Dreyfus légèrement au bras. Il s'agissait, pour l'Action française, de perturber au mieux cette cérémonie en visant « les deux traîtres » : Zola et Dreyfus[236]. Mais aussi de refaire le procès Dreyfus au travers d'un nouveau procès, une revanche en quelque sorte. Le procès aux Assises de la Seine, d'où Grégori sort acquitté, dernière d'une longue série de fautes judiciaires, est l'occasion de nouvelles émeutes antisémites que le gouvernement réprime mollement[237].
Officier de réserve, Dreyfus est mobilisé en 1914 au camp retranché de Paris, comme chef d'un parc d'artillerie, puis affecté en 1917 au Chemin des Dames et en 1918 à Verdun. Il termine la Première Guerre mondiale au rang de lieutenant-colonel et est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur[238]. Il meurt le à l'âge de soixante-seize ans dans l'indifférence générale. Le colonel Picquart est lui aussi réhabilité officiellement et réintégré dans l'armée en 1906 au grade de général de brigade, rétroactivement en date de 1903. Il est même ministre de la Guerre de 1906 à 1909 dans le premier gouvernement Clemenceau. Il meurt en 1914 d'un accident de cheval[239].
L’affaire au prisme du théâtre
Le théâtre de l’époque est particulièrement révélateur du retentissement qu'a alors l’affaire et de sa perception.
Marie Duval a relevé 46 pièces publiées ou jouées de 1895 à 1906 (la majorité entre 1898 et 1901) et traitant ou s’inspirant directement de l’affaire (voir l’annexe Théâtre), et cette liste n'est pas exhaustive. De grandes plumes s’y emploient : Seymour Hicks, Alfred Jarry, Julien Benda… Ce théâtre ne manque pas de surprendre : en France, on compte 22 œuvres classées comme dreyfusardes et 5 comme anti-dreyfusardes. À l’étranger, (Europe et Amériques), les 19 œuvres sont toutes dreyfusardes. Et les plus anciennes ne sont pas données en France, mais en Angleterre et aux Pays-Bas[240]. Ceci donne raison à Clemenceau : « Quant à l’opinion de l’étranger sur l’affaire Dreyfus, nous avons répété cent fois qu’elle était unanime, […] unanime contre le Gouvernement qui s’emploie au profit des coupables à fausser la justice de la loi »[241]. Le monde ne comprend pas la France : il est devenu évident que Dreyfus n’est pour rien dans la trahison, or non seulement l’état-major s’enferme dans, au mieux, ce qu’il croit être la défense de l’institution, mais une grande partie de la classe politique le soutient dans cette impasse, et une frange vociférante de la population s’enflamme dans l’antisémitisme et l’irrationalité[240].
Face à eux, le théâtre tente de faire parler la voix de la raison, comme Romain Rolland dans Les Loups : il y restitue en termes philosophiques le débat entre défense de la Nation et défense de la Justice[242]. Bien sûr le théâtre est rebelle, et l’affaire est aussi l’occasion d’affirmer les positions d’intellectuels qui peuvent aussi être militants ou sympathisants anarchistes (Charles Malato), pacifistes (Romain Rolland), etc. Mais le personnage de Dreyfus et la défense de la communauté juive ne sont pas au centre des œuvres. C’est l’injustice, celle qui touche aussi les classes populaires, qui est avant tout dénoncée, c’est l’erreur judiciaire qui révolte[240]. Les antidreyfusards ne sont pas tous antisémites, mais l’inverse est aussi vrai : on peut être antisémite et dreyfusard. Romain Rolland ou Charles Malato sont plus qu’ambigus. Plus que l’affaire Dreyfus, le théâtre met en scène une affaire sans Dreyfus, dont le héros est Picquart et non lui[240],[242]. Longtemps absent, sans doute est-il ensuite trop effacé, trop sobre, trop respectueux de l'armée et de l'ordre pour être le héros pour le costume duquel Picquart est taillé. Est-ce pourquoi, par la suite, le théâtre s’intéressera si peu à l’affaire[242] ? En revanche, Esterhazy, Bertillon ou Du Paty de Clam y sont éreintés[242].
Conséquences de l'affaire Dreyfus
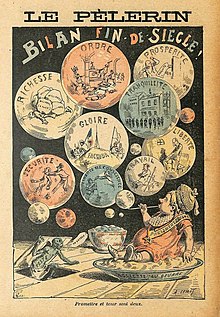
Pour certains, l'affaire Dreyfus a marqué la société française au fer rouge[243]. Tous les compartiments de la société sont touchés, certains sont bouleversés.
Des conséquences politiques
L'affaire fait revivre l'affrontement des deux France[244]. Toutefois, cette opposition sert l'ordre républicain, selon tous les historiens. On assiste en effet à un renforcement de la démocratie parlementaire et à un échec des forces monarchistes et réactionnaires. L'extrême violence des nationalistes rassemble les républicains en un front uni, mettant en échec les tentatives de retour à l'ordre ancien[245]. À court terme, les forces politiques « progressistes », issues des élections de 1893, confirmées en 1898, en pleine affaire Dreyfus, disparaissent en 1899. Le choc des procès Esterhazy et Zola amène une politique dreyfusienne dont le but est de développer une conscience républicaine et de lutter contre le nationalisme autoritaire qui s'exprime lors de l'Affaire. Car la progression désinhibée d'un nationalisme de type populiste est une autre grande conséquence de l'événement dans le monde politique français, et ce même s'il n'est pas né avec l'affaire Dreyfus, puisque le nationalisme est théorisé par Maurice Barrès dès 1892[246]. Le nationalisme connaîtra des hauts et des bas, mais parviendra à se maintenir en tant que force politique, entre autres à travers l'Action française, jusqu'à la défaite de 1940. Après cinquante ans de combat, elle accède au pouvoir et peut réaliser le vieux rêve de Drumont, « purifier » l'État avec les conséquences que chacun sait. On note à cette occasion le ralliement de nombreux républicains à Vichy, sans qui le fonctionnement de l'État eût été précaire, montrant en cela la fragilité de l'institution républicaine dans des circonstances extrêmes[247]. À la Libération, Charles Maurras, condamné le pour faits de collaboration, s'écrie au verdict : « C'est la revanche de Dreyfus ! ».
L'Affaire produit, par effet de réaction, une autre conséquence : la mutation intellectuelle du socialisme. Jaurès est un dreyfusard tardif (), convaincu par les socialistes révolutionnaires[248]. Mais son engagement devient résolu, aux côtés de Georges Clemenceau à partir de 1899, sous l'influence de Lucien Herr. L'année 1902 voit la naissance de deux partis : le Parti socialiste français, qui rassemble les jaurésiens, et le Parti socialiste de France, sous influence de Guesde et Vaillant. Les deux partis fusionnent en 1905 dans la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO).
Par ailleurs, 1901 voit la naissance du Parti républicain, radical et radical-socialiste, premier parti politique moderne[249] conçu comme une machine électorale de rassemblement républicain. Il a une structure permanente et s'appuie sur les réseaux dreyfusards. La création de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen est contemporaine de l'affaire. C'est le creuset d'une gauche intellectuelle extrêmement active au début du siècle, conscience de la gauche humaniste.
Enfin le tournant du siècle voit un renouvellement profond du personnel politique. De grandes figures républicaines, à commencer par Auguste Scheurer-Kestner, disparaissent. Ceux qui ont pu peser fortement sur les événements de l'affaire à la fin du siècle font désormais place à des hommes nouveaux, dont l'ambition est de réformer et de corriger les erreurs et injustices commises auparavant.
Selon l'historien Simon Epstein, dans son ouvrage Les Dreyfusards sous l'Occupation, une autre conséquence à long terme sera de permettre la généralisation d'une interprétation particulière de l’Histoire de France selon laquelle s'opposeraient deux blocs : l'un à gauche, incarnant le Bien, l'autre à droite, identifié au Mal. Cette écriture de l’histoire séparant deux France se poursuivra une grande partie du XXe siècle, présentant finalement la Résistance comme l'héritière du parti dreyfusard, et inversement la Collaboration comme celle des antidreyfusards. Cette vision idéalisée ou manichéenne de l'histoire n'épargnera pas l'historiographie ultérieure qui, d'après Simon Epstein, tend à minimiser le collaborationnisme issu de la gauche politique et à mettre au contraire en avant celui venant de la droite[250].
Des conséquences sociales

Socialement, l'antisémitisme est au-devant de la scène. Préexistant à l'affaire Dreyfus, il s'était exprimé lors des affaires du boulangisme et du canal de Panama. Mais il était restreint à une élite intellectuelle. L'affaire Dreyfus répand la haine raciale dans toutes les couches de la société, mouvement qui débute certes avec le succès de La France juive d'Édouard Drumont en 1886, mais énormément amplifié ensuite par les divers épisodes judiciaires et les campagnes de presse pendant près de quinze ans. L'antisémitisme est donc dès lors officiel et exposé dans de nombreux milieux, y compris ouvriers[252]. Des candidats aux élections législatives font de l'antisémitisme un argument électoral. Cet antisémitisme est renforcé par la crise de la séparation des églises et de l'État à partir de 1905, l'amenant probablement à son paroxysme en France. Le passage aux actes viendra avec l'avènement du régime de Vichy en 1940, laissant libre cours à l'expression débridée et complète de la haine raciale. Des lois antisémites sont appliquées, de nombreux Juifs sont arrêtés par la police française, et le gouvernement de la collaboration participe à la déportation de dizaines de milliers d'entre eux. Au sortir de la guerre, la monstruosité de la Shoah, reconnue comme un crime contre l'humanité, s'impose à tous, discréditant l'antisémitisme. Ce dernier s'exprime pourtant de temps à autre au travers de déclarations de partis d'extrême droite. La persistance d'un sentiment antisémite résiduel en France est toujours d'actualité, comme le montrent par exemple les crimes et délits qui continuent d'être perpétrés[n 46].
Autre conséquence sociale, le rôle renforcé de la presse : elle exerce durant l'Affaire une influence sur la vie politique française qu'elle n'avait jamais eu à ce point[253]. On peut parler d'un quatrième pouvoir, dès lors qu'elle vient contrebalancer l'action du pouvoir judiciaire et politique de l'État[254]. Dans l'Affaire, la haute tenue rédactionnelle de la presse est principalement le fait d'écrivains et de romanciers utilisant les journaux comme un moyen révolutionnaire d'expression. La puissance de la presse a très certainement porté les hommes politiques à l'action, à l'exemple d'un Mercier qui paraît avoir poussé au procès Dreyfus en 1894 pour plaire à La Libre Parole quand celle-ci l'attaquait férocement. Cela dit, le rôle de la presse est limité par la diffusion des titres, à la fois importante à Paris et faible à l'échelle nationale[255]. L'ensemble du tirage de la presse nationale paraît tourner autour de quatre millions et demi d'exemplaires, ce qui relativise fortement son influence réelle. On assiste par ailleurs en 1899 à la parution d'une presse spécifique destinée à coordonner la lutte (dans le camp dreyfusiste), avec le Journal du Peuple de Sébastien Faure.
Des conséquences internationales

L'affaire Dreyfus crée des difficultés sur le chemin de l'amélioration des rapports entre la France et l'Italie après la guerre douanière, l'Italie étant la nation d'Europe la plus dreyfusarde[256].
Le choc de l'affaire Dreyfus a également un impact sur le mouvement sioniste « qui y trouve un terrain propice à son éclosion »[257].
Le journaliste austro-hongrois Theodor Herzl ressort profondément marqué de l'affaire Dreyfus dont il suit les débuts comme correspondant de la Neue freie Presse de Vienne, pour laquelle il assiste à la dégradation d'Alfred Dreyfus en 1895. « L'affaire […] agit comme un catalyseur dans la conversion de Herzl ». Devant la vague d'antisémitisme qui l'accompagne, Herzl se « convainc de la nécessité de résoudre la question juive », qui devient « une obsession pour lui ». Dans son livre Der Judenstaat (L'État des Juifs), il considère que[257] :
« Si la France — bastion de l'émancipation, du progrès et du socialisme universaliste — [peut] se laisser emporter dans un maelström d'antisémitisme et laisser la foule parisienne scander "À mort les Juifs !", où ces derniers peuvent-ils encore être en sécurité — si ce n'est dans leur propre pays ? L'assimilation ne résoudra pas le problème parce que le monde des gentils ne le permettra pas, comme l'affaire Dreyfus l'a si clairement démontré. »
Le choc est d'autant plus fort qu'ayant vécu toute sa jeunesse en Autriche, pays où existe un courant politique antisémite influent, Herzl a choisi d'aller vivre en France pour l'image humaniste dont elle se prévaut à l'abri des excès extrémistes.
Il organise dès 1897, le 1er congrès sioniste à Bâle[258] et est considéré comme l'« inventeur du sionisme en tant que véritable mouvement politique »[257]. L'affaire Dreyfus marque aussi un grand tournant dans la vie de nombreux Juifs d'Europe centrale et occidentale, tout comme les pogroms de 1881-1882 l'avaient fait pour les Juifs d'Europe orientale[257].
Historiographie de l'affaire Dreyfus

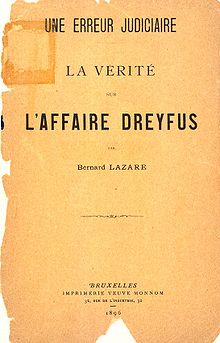
L'affaire Dreyfus se distingue par le nombre important d'ouvrages[259] publiés à son sujet[n 47]. Une partie importante de ces publications relève de la simple polémique et ne sont pas des livres historiques[259]. Mais ces ouvrages sont consultés dans le cadre d'études psycho-sociales de l'affaire[260].
Le grand intérêt de l'étude de l'affaire Dreyfus réside dans le fait que toutes les archives sont aisément disponibles. Bien que les débats du Conseil de guerre de 1894 n'aient pas été pris en sténographie, les comptes-rendus de toutes les audiences publiques des nombreux procès de l'affaire peuvent être consultés. Par ailleurs, un grand nombre d'archives sont facilement accessibles aux Archives nationales et aux Archives militaires du fort de Vincennes.
Une littérature contemporaine de l'affaire a été publiée entre 1894 et 1906. À commencer par l'opuscule de Bernard Lazare, premier intellectuel dreyfusard : malgré des erreurs factuelles, il reste un témoignage des étapes vers la révision[261].
L'ouvrage de Joseph Reinach, l'Histoire de l'affaire Dreyfus en sept volumes, qui commence à paraître en 1901 et se termine avec l'index en 1911, a été la référence jusqu'à la publication des travaux d'histoire scientifique livrés à partir des années 1960. Il contient de très nombreuses informations exactes, malgré quelques interprétations généralement contestées sur le pourquoi de l'affaire[259],[262].
D'autre part, il existe des « mémoires instantanés » de témoins directs, comme le livre antisémite et mensonger d'Esterhazy, ou celui d'Alfred Dreyfus lui-même dans Cinq années de ma vie. Il s'agit de témoignages de nature à compléter le panorama de l'affaire.
Le précis de l'affaire Dreyfus par « Henri Dutrait-Crozon », pseudonyme du colonel Larpent[n 48] est la base de toute la littérature antidreyfusarde postérieure à l'affaire, jusqu'à nos jours. L'auteur y développe la théorie du complot, alimenté par la finance juive, pour pousser Esterhazy à s'accuser du crime. Sous des dehors scientifiques, on y retrouve un échafaudage de théories qu'aucune preuve ne soutient.
La publication des carnets de Schwartzkoppen, en 1930, amène un éclairage sur le rôle coupable d'Esterhazy dans l'affaire et disculpe du même coup Alfred Dreyfus, s'il en était besoin. L'extrême droite conteste la valeur de ce témoignage, mais la plupart des historiens le retiennent comme source valide, malgré quelques ambiguïtés et imprécisions[259].
La période de l'Occupation jette un voile sur l'affaire. La Libération et la révélation de la Shoah amènent une réflexion de fond sur l'ensemble de l'affaire Dreyfus. Jacques Kayser (1946), puis Maurice Paléologue (1955) et Henri Giscard d'Estaing (1960) relancent l'affaire sans grandes révélations, avec une démarche généralement jugée insuffisante sur le plan historique[259],[263].
C'est Marcel Thomas, archiviste paléographe, conservateur en chef aux Archives nationales, qui en 1961, apporte, par son Affaire sans Dreyfus en deux volumes, un renouvellement complet de l'histoire de l'affaire, appuyée sur toutes les archives publiques et privées disponibles. Son ouvrage est le socle de l'ensemble des études historiques ultérieures[264].
Henri Guillemin, la même année, avec son ouvrage L'énigme Esterhazy, croit trouver la clef de « l'énigme » dans l'existence d'un troisième homme (en plus de Dreyfus et Esterhazy)[265], explication qu'il partage momentanément avec Michel de Lombarès[266], avant de l'abandonner quelques années plus tard[263].
Jean Doise, normalien et spécialiste des armées, avec des réflexions et descriptions d'ordre technique, tente d'expliquer l'affaire par la genèse du canon de 75 mm modèle 1897 dans Un secret bien gardé, mais ses hypothèses conclusives sont regardées de manière très critique[263].
Jean-Denis Bredin, avocat et historien, livre L'Affaire en 1983, reconnue comme la meilleure somme sur l'affaire Dreyfus. L'intérêt de l'ouvrage porte sur une relation strictement factuelle et documentée des faits et une réflexion multiforme sur les différents aspects de cet événement.
Il revient enfin à Vincent Duclert d'avoir livré en 2005 la première biographie d'Alfred Dreyfus, en 1 300 pages, parmi une dizaine d'autres publications sur l'affaire Dreyfus, incluant la correspondance complète d'Alfred et Lucie Dreyfus de 1894 à 1899.
En 2014, ont paru deux travaux qui reviennent sur l'histoire de l'Affaire : Histoire politique de l'affaire Dreyfus de Bertrand Joly (Fayard) qui analyse l'Affaire « de l'extérieur » en la replaçant dans le contexte politique de la période et L'Histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours (Les Belles Lettres) de Philippe Oriol qui procède « de l'intérieur » et, sur la base d'un siècle de publications et du dépouillement systématique de la presse française et des fonds d'archives connus et jusqu'alors inconnus, livrant ainsi de très nombreux inédits, propose une narration analytique de l'événement plus précise.
Par ailleurs, l'affaire Dreyfus a fourni la matière de nombreux romans. La dernière œuvre d'Émile Zola (1903), Vérité, transpose l'affaire Dreyfus dans le monde de l'école. Anatole France publie L'Île des pingouins (1907) qui relate l'affaire au livre VI : « L'Affaire des quatre-vingt mille bottes de foin »[267]. D'autres auteurs y contribueront, comme Roger Martin du Gard (Jean Barois), Marcel Proust (Jean Santeuil), Maurice Barrès (Ce que j'ai vu à Rennes) ou plus récemment encore le Britannique Robert Harris avec D. (2013).
Voir aussi
![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
Sources primaires
- Compte rendu in extenso du procès d'Émile Zola aux Assises de la Seine et à la Cour de cassation (1898)

- Enquête de la Cour de cassation (1898-1899)

- Débats de la Cour de cassation en vue de la révision du procès Dreyfus (1898)

- Compte rendu in extenso du procès de Rennes (1899) Tome 1, Tome 2, Tome 3

- Mémoire d'Alfred Dreyfus pour la Cour de cassation (1904)

- Enquête de la Cour de cassation (1904)

- Débats de la Cour de cassation (1906)

- Décision de la Cour de cassation en vue de la cassation sans renvoi du procès Dreyfus de 1899. (1906)

Témoignages
- Alfred Dreyfus, Cinq années de ma vie, 1894-1899, Paris, Fasquelle, Paris (réimpr. 2006 (La Découverte), 2015 (Théolib)) (1re éd. 1901), 277 p. (ISBN 2707148067, lire en ligne sur Gallica)
- Alfred Dreyfus, Lettres d'un innocent, Éditions Stock, (lire en ligne sur Gallica). Réédition Théolib, Paris, 2013 (ISBN 978-2-36500-070-3)
- Alfred Dreyfus, Carnets 1899-1907, Calmann-Lévy, 1998.
- Péguy publie, du 1er février au 15 novembre 1899, une série de 11 articles dans La Revue blanche
- La voix d'Alfred Dreyfus enregistrée en 1912
- Léon Blum, Souvenirs sur l'Affaire, Flammarion, Folio Histoire, 1993 (ISBN 978-2070327522)
- Georges Clemenceau, L'Iniquité, Stock, 1899, lire en ligne
- Georges Clemenceau, La Honte, 1903
- Georges Clemenceau, Vers la réparation, Tresse & Stock, 1899
- Bernard Lazare, L'Affaire Dreyfus : une erreur judiciaire, Stock, 1897
- Mathieu Dreyfus, L'Affaire telle que je l'ai vécue, Bernard Grasset, Paris, 1978. (ISBN 2-246-00668-6)

- Jean Jaurès, Les Preuves, recueil d'articles parus dans La Petite République, 1898.
 Disponible sur Wikisource
Disponible sur Wikisource - Octave Mirbeau, L'Affaire Dreyfus, Librairie Séguier, 1991.
- Maurice Paléologue, L'Affaire Dreyfus et le Quai d'Orsay, Plon,

- Émile Zola, Combat pour Dreyfus. Préface de Martine Le Blond-Zola. Postface de Jean-Louis Lévy. Présentation et notes d'Alain Pagès. Éditions Dilecta, 2006.

- Paschal Grousset, L'Affaire Dreyfus et ses ressorts secrets : précis historique, éd. Godet et Cie, Paris, 240 p., 1898.
- Paschal Grousset, L'Affaire Dreyfus, le mot de l'énigme, Paris, Stock. 1899.
Bibliographie
Bibliographie de référence
- Joseph Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Éditions Fasquelle, ; éd. Robert Laffont, deux vol., 2006[268]

- Marcel Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, Fayard, Idégraf (Genève), 1961-1979, 2 volumes.

- Jean-Denis Bredin, L'Affaire, Paris, Éditions Julliard, , 551 p. (ISBN 2-260-00346-X). Réédition : Jean-Denis Bredin, L'Affaire, Paris, Fayard, , 856 p. (ISBN 2-213-03138-X).

- Vincent Duclert, Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote, Paris, Fayard, , XII-1259 p. (ISBN 978-2-213-62795-3).
 .
. - Louis Leblois, L'affaire Dreyfus : l'iniquité, la réparation, les principaux faits et les principaux documents, Saint-Martin-de-Bonfossé, Théolib, coll. « Résistances », (1re éd. 1929 (Aristide Quillet)) (ISBN 978-2-36500-002-4)
Autres ouvrages généraux
- Pierre Birnbaum, L'affaire Dreyfus : la République en péril, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard : histoire » (no 213), , 144 p. (ISBN 2-07-053277-1).

- Pierre Birnbaum (dir.), La France de l'affaire Dreyfus, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », , 597 p. (ISBN 2-07-073700-4).
- Michael Burns, Histoire d'une famille française, les Dreyfus, Fayard, , 700 p. (ISBN 978-2213031323).

- Éric Cahm, L'Affaire Dreyfus, Le Livre de poche, coll. « références », 1994
- Francis Démier, La France du XIXe siècle, Seuil, coll. « Points Histoire », .

- Michel Drouin (dir.), L'affaire Dreyfus de A à Z, Paris, Flammarion, , 713 p. (ISBN 2-08-066930-3, présentation en ligne). Réédition : Michel Drouin (dir.), L'Affaire Dreyfus : dictionnaire, Paris, Flammarion, , 759 p. (ISBN 2-08-210547-4).

- Vincent Duclert, L'Affaire Dreyfus, Paris, La Découverte, coll. « Repères : histoire » (no 141), (1re éd. 1994), 127 p. (ISBN 2-7071-4793-1, présentation en ligne).

- Vincent Duclert, Dreyfus est innocent, histoire d'une affaire d'État, Paris, Larousse, , 239 p. (ISBN 203582639X).

- Vincent Duclert, L'Affaire Dreyfus. Quand la justice éclaire la République, Privat, .
- Pierre Gervais, Pauline Peretz et Pierre Stutin, Le dossier secret de l'affaire Dreyfus, Paris, Alma éditeur, , 345 p. (ISBN 978-2-36279-043-0, présentation en ligne).
- Bertrand Joly, Histoire politique de l'affaire Dreyfus, Paris, Fayard, , 783 p. (ISBN 978-2-213-67720-0, présentation en ligne), [présentation en ligne].
- Pierre Miquel, L'affaire Dreyfus, Paris, Presses Universitaires de France, PUF, coll. « Que sais-je ? », (réimpr. 2003), 127 p. (ISBN 2130532268).

- Pierre Miquel, La Troisième République, Fayard, , 739 p. (ISBN 978-2213023618)

- Philippe Oriol, L'histoire de l'affaire Dreyfus : de 1894 à nos jours, vol. 1 et 2, Paris, Les Belles Lettres, , 1489 p. (ISBN 978-2-251-44467-3).
- (en) Piers Paul Read, The Dreyfus affair : the story of the most infamous miscarriage of justice in French history, Londres, Bloomsbury, (ISBN 9781408830574).
- Michel Winock, La Fièvre hexagonale : les grandes crises politiques de 1871 à 1968, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Histoire », , 428 p. (ISBN 2-7021-1426-1, présentation en ligne).
 Nouvelle édition revue et augmentée : Michel Winock, La Fièvre hexagonale : les grandes crises politiques de 1871 à 1968, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire » (no H97), , 475 p. (ISBN 978-2-7578-1538-0).
Nouvelle édition revue et augmentée : Michel Winock, La Fièvre hexagonale : les grandes crises politiques de 1871 à 1968, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire » (no H97), , 475 p. (ISBN 978-2-7578-1538-0). - Michel Winock, Le Siècle des intellectuels, Paris, Le Seuil, coll. « Points : essai » (no 613), , 885 p. (ISBN 2-02-036416-6).

Ouvrages spécialisés
- André Bach (général), L'armée de Dreyfus : une histoire politique de l'armée française de Charles X à « l'Affaire », Paris, Éditions Tallandier, , 622 p. (ISBN 2-84734-039-4).

- Patrice Boussel, L'Affaire Dreyfus et la presse, Armand Colin, coll. « Kiosque », , 272 p.

- Jean Doise, Un secret bien gardé, Histoire militaire de l'Affaire Dreyfus, Paris, Éditions du Seuil, 1994, 225 p. , 225 p. (ISBN 2-020211009).

- Jean-Luc Jarnier, L'Affaire Dreyfus et l'imagerie de presse en France (1894-1908), thèse de doctorat en histoire de l'art, 2017, 752 p.
- Georges Joumas, Échos de l'Affaire Dreyfus en Orléanais, Corsaire Éditions, (ISBN 978-2-910475-12-3)
- Philippe-E. Landau, L'opinion juive et l'affaire Dreyfus, Paris, Éditions Albin Michel, coll. « Présences du judaïsme » (no 17), , 152 p., poche (ISBN 2-226-07553-4).
- Thierry Lévy et Jean-Pierre Royer, Labori, un avocat : pour Zola, pour Dreyfus, contre la terre entière, Paris, Audibert, coll. « AUDIBERT LM », , 271 p. (ISBN 9782847490831 et 2847490833)
- Roselyne Koren (dir.) et Dan Michman (dir.), Les intellectuels face à l'affaire Dreyfus alors et aujourd'hui : perception et impact de l'affaire en France et à l'étranger : actes du colloque de l'Université Bar-Ilan, Israël, 13-, Paris, Éditions L'Harmattan, , 351 p. (ISBN 2-7384-6025-9, lire en ligne).

- Cour de Cassation, collectif, De la justice dans l'affaire Dreyfus, Paris, Fayard, , 419 p. (ISBN 2-213-62952-8).

- Alain Pagès, L'affaire Dreyfus, Paris, Éditions Perrin, coll. « Vérités et légendes », , 283 p. (ISBN 978-2-262-07494-4).
- Michel Denis (dir.), Michel Lagrée (dir.) et Jean-Yves Veillard (dir.), L'affaire Dreyfus et l'opinion publique en France et à l'étranger, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 346 p. (ISBN 2-86847-160-9, lire en ligne).
- Gilles Manceron (dir.) et Emmanuel Naquet (dir.), Être dreyfusard, hier et aujourd'hui, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 551 p. (ISBN 978-2-7535-0947-4, lire en ligne).
- Pierre Pierrard, Les chrétiens et l'Affaire Dreyfus, Éditions de l'Atelier, , 216 p.
- Bertrand Tillier, Les artistes et l'affaire Dreyfus, 1898-1908, Seyssel, Éditions Champ Vallon, coll. « Époques », , 373 p. (ISBN 978-2-87673-516-3, présentation en ligne).
Littérature de fiction
Différents écrivains contemporains de l'affaire Dreyfus s'en inspirent dans leurs œuvres, dont Anatole France qui en donne une version satirique avec l'« affaire Pyrot » dans L'Île des Pingouins (1908). Le premier roman à prendre en compte l'affaire elle-même est publié en 1913; il s'agit de Jean Barois où l'auteur, Roger Martin du Gard, en intègre les péripéties réelles dans le cheminement moral du héros éponyme. Marcel Proust l'évoque à plusieurs reprises dans À la recherche du temps perdu, où l'affaire sert de fil rouge courant à travers un certain nombre d'épisodes, et de pierre de touche de la moralité des personnages les plus saillants... jusqu'à G. K. Chesterton qui la met en scène dans une enquête du père Brown, « Le Duel du Dr Hirsch » (La Sagesse du père Brown).
Au XXIe siècle, Umberto Eco en relate les prémices et le déroulement dans Le Cimetière de Prague pendant que Robert Harris lui consacre un thriller intitulé D.
Théâtre
- Seymour Hicks, One of the best (L'un des meilleurs), créée au théâtre Adelphi de Londres, 1895 (anglais), puis un an aux États-Unis[242] ;
- Anton van Sprinckhuysen, Dreyfus, de martelaar van het Duivelseiland (Dreyfus, le martyr de l’île du Diable), drame en huit tableaux et une apothéose créé à Amsterdam le 21 décembre 1897 (néerlandais), puis en Europe[269] ;
- J’accuse… ou le procès Zola , créée au Parckschouwburg d’Amsterdam, 19 février 1898 (néerlandais), interdite quelques jours plus tard à la demande de l’ambassade de France à la Haye[240] ;
- Romain Rolland, Les Loups, drame philosophique en trois actes, créé au théâtre de l’Œuvre, 18 mai 1898[242] ;
- Georges Grison et Albert Dupuy, Fergus, drame patriotique en cinq actes et six tableaux créé aux Bouffes-Parisiens le 29 juin 1898[240] ;
- Le Procès Dreyfus ou le condamné de l’île du diable, créée au théâtre Tacon de La Havane, 20 septembre 1898 (espagnol)[240] ;
- Alfred Jarry, L’Île du Diable, pièce secrète en trois ans et plusieurs tableaux, écrite en 1899[242] ;
- Julien Benda, Dialogues à Byzance, dialogue philosophique publié par La Revue blanche (1900) ;
- Dep, L’Or Dieu, publiée en 1901, commençant ainsi : « Tous les personnages ont le type juif accentué. Blenhoff se distingue par des yeux ronds hors de la tête. Il ressemble à un bouledogue »[240] ;
- Ortego de Quintana, Le Procès Dreyfus, créée au Théâtre National de San Salvador (janvier 1906)[240] ;
- Wilhelm Herzog et Hans Rehfisch, L’Affaire Dreyfus (1930), traduite par Jacques Richepin et jouée au théâtre de l’Ambigu, interrompue à cause de manifestations organisées par l’Action Française[242] ;
- Jean-Claude Grumberg, Dreyfus, écrite en 1974 (l’action se déroule en 1930 en Pologne, autour de la répétition d’une pièce sur l’affaire)[242] ;
- Bernard Matignon, L'Affaire Dreyfus, d'après L'Affaire, de Jean-Denis Bredin, lecture au Festival d'Avignon, .
Filmographie
En regard de l'importance de l'événement et de ses répercussions, l'affaire Dreyfus a été portée à la fois sur le petit et le grand écran français et international[270].
Actualités et assimilés
- 1899 :
- La Garde en faction devant le tribunal de Rennes, Catalogue des vues Lumière.
- Mme Dreyfus et son avocat à la sortie de la prison de Rennes, Catalogue des vues Lumière.
- L'Affaire Dreyfus (actualité reconstituée, onze tableaux, 15 min) de Georges Méliès (point de vue dreyfusard), DVD 2008 par Studio Canal
- L'Affaire Dreyfus (actualité reconstituée, six tableaux), Actualités Pathé
- 1902 : L'Affaire Dreyfus de Ferdinand Zecca produit par Pathé
- 1907 : L'Affaire Dreyfus de Lucien Nonguet produit par Pathé
Cinéma
- 1899 :
- L'Affaire Dreyfus de Georges Méliès
- Arrestation, Aveux du colonel Henry
- Au mont Valérien, Suicide du colonel Henry
- Avenue de la Gare à Rennes
- Dreyfus dans sa cellule à Rennes
- Entrée au conseil de guerre
- Prison militaire de Rennes rue Duhamel
- Sortie du conseil de guerre
- 1930 : Dreyfus de Richard Oswald
- 1931 : (en) Dreyfus, Film anglais de F.W. Kraemer et Milton Rosmer, noir et blanc, 90 min
- 1937 : La Vie d'Émile Zola de William Dieterle, noir et blanc, 90 min
- 1958 : L'Affaire Dreyfus de José Ferrer
- 1978 : Dreyfus ou l'Intolérable Vérité de Jean Chérasse
- 2019 : J'accuse de Roman Polanski
Télévision
Documentaires
- 1966 : L'Affaire Dreyfus de Jean Vigne, réalisé pour les écoles, noir et blanc, 18 min.
- 1994 :
- La Raison d'État, Chronique de l'Affaire Dreyfus de Pierre Sorlin, Couleur, 26 min.
- Les Brûlures de l'Histoire épisode L'affaire Dreyfus de Rober Mugnerot.
- 2015 : L'ombre d'un doute, Le dossier secret de l'affaire Dreyfus.
- 2017 : Karambolage, l'Affaire Dreyfus.
Téléfilms
- 1968 : (cs) Dreyfusova aféra, série tchécoslovaque en trois parties
- 1978 : Émile Zola ou la Conscience humaine de Stellio Lorenzi, Produit par Antenne 2, Couleur.
- 1991 :
- (en) Can a Jew Be innocent ?, film anglais en quatre épisodes de Jack Emery, Produit par la BBC, Couleur, 30 min.
- (en) Prisoners of Honor, film américain de Ken Russel, Couleur, 105 min.
- 1994 : Rage et Outrage de George Whyte, film français, Produit par ARTE, Couleur.
- 1995 :
- L'Affaire Dreyfus de Yves Boisset.
- (en) Dreyfus in Opera and Ballett, film allemand et anglais, Produit par WDR, Couleur.
Articles connexes
Personnalités
Événements
- Crises de la Troisième République (1870-1940) : Commune de Paris (1871), Faillite de l'Union générale (1882), Scandale des décorations (1887), Affaire Schnaebelé (1887), Boulangisme (1886-1889), Scandale de Panama (1892), Fort Chabrol (1899), Affaire des Fiches (1904), Affaire Thalamas (1908), Première Guerre mondiale (1914-1918), Affaire Stavisky (1933), Affaire Mortara (1858), Crise du 6 février 1934.
- Affaire Liabeuf, l'« affaire Dreyfus des ouvriers » (1910).
- Affaire Durand, l'« affaire Dreyfus du monde du travail » (1910).
Événements concernant l'affaire Dreyfus
- : Hommage du Sénat à Auguste Scheurer-Kestner.
- : Le Sénat inaugure le monument Scheurer-Kestner.
Mouvements et politique
- Journaux et organisations : Action française, L'Aurore, La Libre Parole, Ligue de la patrie française, Ligue des droits de l'Homme (1898), La Petite République.
- Antisémitisme → Antisémitisme français : Édouard Drumont, Jules Guérin.
- Politique : Nationalisme français, Revanchisme, Radicaux.
Société
Liens externes
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- L'affaire Dreyfus, réalisé, en 2013, en collaboration avec le Service historique de la Défense, concerne l'histoire de l'affaire et la numérisation du dossier secret.
- Dossiers pédagogiques concernant l'affaire Dreyfus, Archives municipales de Rennes.
- 1906 Dreyfus site du ministère de la culture.
- Numérisation complète du dossier secret au Service historique de la Défense.
- Site de la Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus (SIHAD). Documents et études sur l'Affaire.
- Site de l'Assemblée nationale.
- 36 photos prises sur le vif au procès de Rennes par Auguste Hautebert.
- Affaire Dreyfus sur le site de la police technique et scientifique.
- Le centenaire de l'affaire Dreyfus (X 1878) sur le site de la Société des amis de la bibliothèque et de l'histoire de l'École polytechnique.
- Alfred Dreyfus, une affaire polytechnicienne sur le site de La Jaune et la Rouge.
- Site de Maison Zola-Musée Dreyfus (dans le domaine d'Émile Zola à Médan)
Notes et références
Notes
- Dreyfus est de Mulhouse, comme Sandherr et Scheurer-Kestner, Picquart est strasbourgeois, Zurlinden est colmarien.
- car entre un régime autocratique et religieux et une république laïque (Auguste Scheurer-Kestner dans une allocution au Sénat).
- Il est l'objet de la lettre interceptée par le SR français, appelée « Canaille de D… ». Elle est utilisée dans le « dossier secret » pour faire condamner Dreyfus.
- Le fameux comte Esterhazy sera, de façon ironique, l'un des témoins de Crémieu-Foa.
- Hypothèses car les preuves n'existent pas.
- Jargon du SR signifiant : documents récupérés par la femme de ménage de l'ambassade d'Allemagne[20].
- Voir Hypothèses liées à l'affaire Dreyfus.
- Et non pas en tout petits morceaux. De plus le papier n'était pas froissé[21].
- La seule information importante du document consiste en une note sur le canon de 120 C Baquet, pièce d'artillerie qui n'aura représenté que 1,4 % du parc d'artillerie moderne français en 1914, et 0,6 % de toute l'artillerie[22].
- On prétend dans de nombreux livres que Dreyfus est sans émotion et indifférent à son sort ce qui est en définitive démenti par de nombreux témoignages[35].
- Le général rencontre le président de la République, Casimir-Perier, en minimisant l'importance des pièces transmises, ce que Mercier niera ensuite, opposant irréductiblement les deux hommes[41].
- Du général Saussier, gouverneur de la place de Paris notamment.
- Expert en écritures à la Banque de France : son honnête prudence est vilipendée dans l'acte d'accusation du commandant d'Ormescheville.
- Aucun prévenu ne peut être mis au secret dans aucune loi de l'époque. Les risques de fuite étant limités du fait que les avocats sont soumis au secret professionnel[55].
- Le rapport d'un agent de la section des statistiques, François Guénée, a en effet présenté le capitaine Dreyfus sous un jour très défavorable (jeu, femme, besoin d'argent).
- Trois démentis, très mous et ambigus sont publiés par l'agence Havas en novembre et décembre 1894 dans le but de dégager la responsabilité de l'ambassade d'Allemagne[65].
- Joseph Reinach indique que « plusieurs journaux du 21 décembre prêtent cette formule à un membre du conseil de guerre (Patrie, Intransigeant, Gil Blas) »[72].
- Voir les démonstrations de Meyer, Giry, Henri Poincaré, d'Appel et de Darboux, les plus grands paléographes et les plus célèbres mathématiciens du XIXe siècle lors de leurs dépositions de la seconde révision en 1904. Ils ont détruit pour toujours le système Bertillon[80].
- Il s'agissait en fait d'un dénommé Dubois, identifié par la Section de statistiques depuis un an[87].
- Clemenceau écrit le , dans La Justice :
« Sans doute, je suis aussi résolument que jamais l'ennemi de la peine de mort. Mais on ne fera jamais comprendre au public qu'on ait fusillé, il y a quelques semaines, un malheureux enfant de 20 ans coupable d'avoir jeté un bouton de sa tunique à la tête du président du conseil de guerre, tandis que le traître Dreyfus, bientôt, partira pour l'île de Nou [sic], où l'attend le jardin de Candide [sic][91]. »
- C'est lui qui avait reçu le capitaine le matin du 15 octobre 1894, lors de la scène de la dictée.
- Cassagnac, pourtant antisémite, fait paraître un article intitulé Le Doute, mi-septembre 1896.
- Autrement appelé « faux patriotique » par les antidreyfusards.
- Alexandrine, signature usuelle de Panizzardi.
- Le , un télégramme de Panizzardi au général Marselli est intercepté et déchiffré : « Se capitano dreyfus non ha avuto relazione costa sarebbe conveniente incaricare ambasciatore smentire ufficialmente evitare commenti stampa » (« Si le capitaine Dreyfus n'a pas eu de relations avec vous, il conviendrait de faire publier par l'ambassadeur un démenti officiel pour éviter les commentaires de la presse »). Le télégramme tend donc au contraire à disculper Dreyfus[126].
- Henry ambitionnait la succession de Sandherr, ayant été son adjoint de longues années. Mais Picquart avait été nommé chef du SR comme on le sait. Le limogeage de Picquart va permettre à Henry d'assouvir son ambition[131].
- Selon l'historien Vincent Duclert, il convient de distinguer les « dreyfusards », les « dreyfusiens » et les « dreyfusistes »[135].
Les « dreyfusards » sont les premiers défenseurs de Dreyfus, ceux qui le soutiennent dès le début tandis que le terme « dreyfusiste » désigne ceux qui réfléchissent au-delà de l'affaire et voient en celle-ci une nécessité de remettre en cause la société et la politique et, par extension, le fonctionnement de la République (certains dreyfusards seront parfois aussi dreyfusistes par la suite)[135].
Quant aux « dreyfusiens », ils n'apparaissent qu'en , lorsque l'affrontement entre dreyfusards et antidreyfusards devient vraiment aigu et que l'affaire compromet la stabilité de la République. Les dreyfusiens, même si certains ont des sympathies pour Alfred Dreyfus, veulent liquider l'affaire en calmant le jeu dans le but de sauver le régime républicain parlementaire alors en place[135],[136]. Ils sont à l'origine d'une certaine conciliation entre les deux camps, grâce à un effort de médiation, en prônant l'apaisement. Leur texte fondateur est « L'Appel à l'union », paru le dans le journal Le Temps. Ils soutiennent généralement la politique de Waldeck-Rousseau et prônent une laïcisation de la société. - Il était déjà intervenu dans Le Figaro en mai 1896, dans l'article « Pour les Juifs ».
- Suivi du Syndicat le et de Procès-verbal le .
- Alors au cœur de l'avant-garde artistique, publiant Marcel Proust, Saint-Pol-Roux, Jules Renard, Charles Péguy, etc.
- Le concept naît avec un sens profondément péjoratif, afin de dénoncer, comme l'écrit Ferdinand Brunetière, « la prétention de hausser les écrivains, les savants, les professeurs, les philologues, au rang des surhommes »[140].
- La chose jugée est tenue pour véridique.
- La salle est vidée dès que les débats abordent des sujets touchant à la défense nationale, c'est-à-dire le témoignage de Picquart.
- Le président Delegorgue refuse de l'interroger alors qu'elle est appelée à la barre.
- Le rôle du général Mercier est ainsi fortement sous-estimé.
- Le 2 février, Octave Mirbeau, Laurent Tailhade, Pierre Quillard et Georges Courteline, entre autres, signent dans L'Aurore une « Adresse à Émile Zola » l'assurant de leur soutien « au nom de la Justice et de la Vérité ».
- Exemple d'un échange entre Fernand Labori, avocat de la défense et le président de la Cour d'assise Delegorgue :
« Me Labori. — Je vous demande pardon, monsieur le Président, d'intervenir, mais il serait intéressant d'entendre MM. Couard, Belhomme et Varinard.
M. Le président. — Non, non ; j'ai dit …
Me Labori. — Mais j'ai une question à poser.
M. Le président. — Vous ne la poserez pas.
Me Labori. — J'insiste, monsieur le Président.
M. Le président. — Je vous dis que vous ne la poserez pas.
Me Labori. — Oh ! Monsieur le Président ! Il est intéressant…
M. Le président. — C'est inutile de crier si fort.
Me Labori. — Je crie parce que j'ai besoin de me faire entendre.
M. Le président. — La question ne sera pas posée.
Me Labori. — Permettez, vous dites cela ; mais je dis que je veux la poser.
M. Le président. — Eh bien ! Je dis que non, et c'est une affaire entendue ! Le Président doit écarter du débat tout ce qui peut allonger les débats sans aucune utilité ; c'est mon droit de le faire.
Me Labori. — Vous ne connaissez pas la question ; vous ne savez pas quelle est la question.
M. Le président. — Je sais parfaitement ce que vous allez demander.
Me Labori. — Eh bien, je dépose des conclusions pour avoir un arrêt de la Cour sur ce point.
M. Le président. — Toutes les conclusions que vous voudrez.
Me Labori. — Si vous croyez que cela va raccourcir les débats, vous vous trompez.
M. Le président. — Eh bien nous statuerons sur les conclusions pendant la suspension d'audience.
(À l'huissier audiencier) Un autre témoin.
(M. Auguste Molinier se présente à la barre et prête serment.)
M. Le président au greffier. — Le témoin est-il cité régulièrement ?
M. le greffier. — Oui monsieur le Président.
M. Le président. — Quelle est la question Maître Labori ?
Me Labori. — Je vous demande pardon, je rédige des conclusions, et je considère qu'il est absolument indispensable que la déposition de M. Paul Meyer et les incidents qu'elle comporte comme discussions soient finis avant la déposition du nouveau témoin. Je n'ai besoin que de deux minutes ; je demande respectueusement que vous me les accordiez et j'interrogerai ensuite le témoin.
M. Le président. — Mais le témoin vient de prêter serment ; il faut absolument qu'on l'interroge maintenant.
Me Clemenceau. — C'est une question de deux minutes.
M. Le président. — Mais posez donc votre question dès maintenant ; c'est inutile de perdre notre temps.
Me Labori. — Je crois que l'audition de MM. Couard, Belhomme et Varinard est indispensable à la manifestation de la vérité et je tiens à ce que le refus de l'ordonner soit constaté avant que le témoin dépose : je considère cela comme indispensable au point de vue de la défense.
(M. le Président feuillette le Code d'instruction criminelle.)
M. Le président à M. A. Molinier. — Monsieur, voulez-vous vous retirer s'il vous plaît.
(À l'huissier audiencier.) Voulez-vous faire retirer le témoin, s'il vous plaît.
(Me Labori rédige ses conclusions.) », Procès Zola p. 503-505. - Les circonstances du décès d'Henry ne sont toujours pas éclaircies et ont nourri quelques fantasmes. L'assassinat est peu probable[180].
- Des 40 membres de l'Académie française, Anatole France est le seul révisionniste.
- Dans les années 1890, les républicains modérés de la nouvelle génération se rebaptisent progressistes, selon le terme utilisé par le jeune Paul Deschanel dans son discours de rentrée après les législatives de 1893.
- La Cour a fait réaliser plusieurs expertises scientifiques minutieuses afin de conclure à des certitudes.
- Maurice Barrès fait une description poignante de Dreyfus.
- Il s'agissait du président du Conseil de guerre et du commandant de Bréon, un catholique qui se rendait « tous les jours à la messe »[219].
- Devant l'évidence de l'identité des écritures du bordereau et d'Esterhazy, l'État-Major avait fait courir le bruit que le bordereau n'était en fait qu'un décalque d'une note commentée de la main même de l'empereur d'Allemagne Guillaume II. Cela permettait à leurs auteurs d'expliquer le secret entourant toute l'affaire, ainsi que la transmission du « dossier secret » en 1894. Évidemment, on n'a jamais retrouvé aucune preuve de ces commodes affirmations.
- Parmi les experts sollicités, on note la contribution du mathématicien et physicien Henri Poincaré.
- Cet antisémitisme est bien entendu d'origines multiples et n'est pas en lui-même une conséquence de l'affaire Dreyfus.
- La bibliographie listée dans le présent article n'expose qu'une faible partie de ce qui a été édité depuis plus d'un siècle.
- Inspiré par le commandant Cuignet.
Références
- Voire un « crime judiciaire » selon Bredin, L'Affaire, Fayard, 1984 et Vincent Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, Fayard, 2006.
- Lire aussi le « discours » du ministre de la Justice, Pascal Clément, du 12 juin 2006.
- Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, p. 15.
- Alfred Dreyfus, une affaire polytechnicienne [lire en ligne].
- « Arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1906 » [PDF], sur assemblee-nationale.fr.
- Michel Winock, « L'affaire Dreyfus comme mythe fondateur », dans La France politique, Éditions du Seuil, coll. « Points Histoire », 2003, p. 151-165.
- « L'assassinat de Sadi Carnot à Lyon », sur RetroNews - Le site de presse de la BnF, (consulté le )
- Jean-Luc Jarnier, « Jean Casimir-Perier, de la fortune financière à l'infortune caricaturale », Sociétés & Représentations, vol. 36, no 2, , p. 51–63 (ISSN 1262-2966, DOI 10.3917/sr.036.0051, lire en ligne, consulté le )
- Pour ces trois paragraphes, cf. Jean-Marie Mayeur, Les débuts de la IIIe République, Éditions du Seuil, 1973, p. 209-217.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 5.
- Sur la mise au point du canon de 75 : Doise, Un secret bien gardé, p. 9 et s.
- Bach, L'armée de Dreyfus, p. 534.
- « Le J’accuse de Polanski, adaptation du D de Robert Harris. Compte rendu », sur affaire-dreyfus.com, Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus (consulté le ).
- Les Juifs dans l'armée.
- Frédéric Viey, L'antisémitisme dans l'Armée : l'Affaire Coblentz à Fontainebleau.
- Miquel, La troisième République, p. 391.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 8.
- Marcel Thomas, L'Affaire sans Dreyfus.
- Voir notamment Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 40-42.
- Thomas, L'affaire sans Dreyfus, p. 140 et s.
- Bredin, L'Affaire, p. 67.
- Doise, Un secret bien gardé, p. 55 et s.
- Jean-Denis Bredin, Dreyfus, un innocent, Fayard, , p. 55.
- Sur la Section de statistiques, voir Bredin, p. 49-50 ; Doise, p. 42-43 et Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, p. 60-70.
- Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, p. 67. Alfred Dreyfus était aussi originaire de Mulhouse.
- « Cette moule de Mercier » affirme Rochefort dans L'Intransigeant, Boussel, L'affaire Dreyfus et la presse, p. 43-44.
- Bredin, L'Affaire, p. 65.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 39.
- Birnbaum, L'Affaire Dreyfus, p. 40.
- Bredin, L'Affaire, p. 68.
- Birnbaum, L'Affaire Dreyfus, p. 48.
- Burns, Une famille…, p. 139.
- Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, p. 260.
- Sandherr était un antisémite forcené. Paléologue, L'Affaire Dreyfus et le Quai d'Orsay.
- Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 115 et s.
- Birnbaum, L'Affaire Dreyfus, p. 38.
- Comme le signale d'ailleurs le général Mercier à ses subordonnés, Bredin, L'Affaire, p. 69.
- Sur les personnalités de Mercier et du Paty de Clam, lire : Paléologue, L'Affaire Dreyfus et le Quai d'Orsay, p. 111 et s.
- Henri Guillemin, L'énigme Esterhazy, Paris, Éditions Gallimard, , 267 p., p. 99.
- Bredin, L'Affaire, p. 0.
- Procès de Rennes Tome 1, p. 60, 149 et 157.
- Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, p. 141. Hanotaux a fait promettre à Mercier d'abandonner les poursuites si d'autres preuves n'étaient pas trouvées. C'est sans doute l'origine du dossier secret.
- Bredin, L'Affaire, p. 72.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 92. Gobert affirme que le texte a été écrit rapidement, excluant la copie.
- Procès de Rennes Tome 2, p. 322. Idée renforcée par la transparence du papier.
- Bredin, L'Affaire, p. 87.
- « La révision du procès Dreyfus ; Débats de la Cour de cassation : rapport de M. Ballot-Beaupré, conclusions de M. le procureur général Manau, mémoire et plaidoirie de Me Mornard, arrêt de la cour p 649 »
- « Histoire de l'affaire Dreyfus: Le procès de 1894 Joseph Reinach Editions de la Revue Blanche, 1901 p. 172 »
- « Le procès Zola devant la cour d'assises de la Seine et la cour de cassation: 7 - 23 février-31 mars - 2 avril 1898 »
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 107.
- Rapport de la Cour de cassation, tome 1, p. 127.
- L'ordre d'arrestation avait été signé d'avance, v. Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, p. 208.
- Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 118.
- Mathieu Dreyfus, L'Affaire telle que je l'ai vécue, p. 20 et s.
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, Duclert, p. 51.
- Maurice Baumont, Au cœur de l'affaire Dreyfus, Del Duca, , p. 59.
- Bredin, L'Affaire, p. 80.
- Mathieu Dreyfus, L'Affaire telle que je l'ai vécue.
- Il qualifie le rapport de du Paty « d'élucubrations », Bredin, L'Affaire, p. 88.
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, Duclert, p. 103.
- Zola, « J'accuse… ! ».
- Bredin, L'Affaire, p. 89.
- Mathieu Dreyfus, L'Affaire telle que je l'ai vécue, p. 24.
- v. La presse et l'édition dans l'affaire Dreyfus et Bredin, L'Affaire, p. 83.
- Bredin, L'Affaire, p. 85.
- « L'espionnage militaire », le Figaro, (lire en ligne) lire en ligne sur Gallica.
- Boussel, L'affaire Dreyfus et la presse, p. 55.
- Arthur Meyer, « Démenti nécessaire », Le Gaulois, (lire en ligne sur Gallica).
- Boussel, L'affaire Dreyfus et la presse, p. 58.
- Boussel, L'Affaire Dreyfus et la Presse, p. 60.
- Philippe Oriol, {L'histoire de l'affaire Dreyfus : de 1894 à nos jours}, Paris, Les Belles Lettres, 2014, note 371.
- Histoire de l’Affaire Dreyfus, p.394.
- Sur les détails du déroulement, lire Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 147 et s.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 394.
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, Duclert, p. 107.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 409.
- Doise, Un secret bien gardé, p. 87.
- Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 151.
- Doise, Un secret bien gardé, p. 38.
- Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, p. 189.
- Picquart, Révision 1898-1899, Instruction, Tome I, p. 129.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 411. Les crucifix avaient disparu des prétoires civils depuis le gouvernement de Jules Ferry, mais pas des tribunaux militaires.
- Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 164.
- Pierre Gervais, Romain Huret et Pauline Peretz, « Une relecture du « dossier secret » : homosexualité et antisémitisme dans l'Affaire Dreyfus », Revue d'histoire moderne et contemporaine, éditions Belin, Vol. 55, no 1, p. 125-160.
- Doise, Un secret bien gardé, p. 132.
- Birnbaum, L'Affaire Dreyfus, p. 43.
- Voir aussi : Pierre Milza, L'Affaire Dreyfus nelle relazioni franco-italiane (en italien), in: Comune di Forlì–Comune di Roma, Dreyfus. L'affaire e la Parigi fin de siècle nelle carte di un diplomatico italiano, Edizioni Lavoro, Roma 1994, p. 23-36.
- Cour de cassation, De la justice dans l'affaire Dreyfus, Duclert, p. 92.
- Procès de Rennes Tome 2 p. 191 et s. Il aggrave notamment son cas en n'admettant pas que la transmission d'un dossier secret fut une manœuvre criminelle.
- Voir l'exemplaire complet sur Gallica.
- Cité par Michel Winock, Clemenceau, éd. Perrin, 2007, chap. XV, « L'entrée dans l'Affaire », p. 244.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 468.
- Armand Israël, Les vérités cachées de l'affaire Dreyfus, Éditions Albin Michel, , p. 471.
- Armand Israël, Les Vérités cachées de l'affaire Dreyfus, Éditions Albin Michel, , p. 110.
- Méhana Mouhou, Affaire Dreyfus: conspiration dans la République, Éd. L'Harmattan, 2006, p. 40.
- Laurent Greilsamer, La Tragédie du Capitaine Dreyfus, Tallandier, , 224 p. (ISBN 979-10-210-0135-0, lire en ligne), p. 69 :
« Le 4 janvier [1895], un soldat de la garde républicaine se rend au greffe et demande l'uniforme du capitaine. Il entaille profondément les coutures des boutons pour qu'ils ne tiennent plus qu'à un fil. Il découd aussi patiemment les galons rouges du pantalon, ce signe distinctif des anciens élèves de l'École Polytechnique. Ce n'est pas fini. Il tire l'épée de son fourreau, s'en empare pour entailler profondément la lame avec une scie à métaux. Une dégradation militaire, cela se prépare. »
- Bredin, L'Affaire, p. 107.
- Il semble que l'orthographe exacte du nom du capitaine soit Lebrun Renaud, mais l'ensemble de la littérature historique adopte la forme du texte, celle-ci étant donc la plus courante. Voir son témoignage au Procès de Rennes Tome 3, p. 73.
- Bredin, L'Affaire, p. 103.
- Philippe Oriol, L'Histoire de l'Affaire Dreyfus T.1 : L'affaire du capitaine Dreyfus, 1894-1897, éditions Stock, 10 septembre 2008, 408 pages.
- « L'adjudant Châtelain », L'Express du Midi, (lire en ligne, consulté le ).
- Bredin, L'Affaire, p. 125.
- Alfred Dreyfus, Cinq années de ma vie.
- Bredin, L'Affaire, p. 132.
- Lire à cet égard les mémoires de Mathieu Dreyfus, L'Affaire telle que je l'ai vécue, restés inédits jusqu'en 1978, sauf quelques extraits.
- Mathieu Dreyfus, L'Affaire telle que je l'ai vécue, Fayard, p. 47.
- Bredin, L'Affaire, p. 117.
- Mathieu Dreyfus, L'Affaire telle que je l'ai vécue p. 48 et s.
- Mathieu Dreyfus, L'Affaire telle que je l'ai vécue, p. 54 et s.
- Lazare, Une erreur judiciaire. La vérité sur l'Affaire Dreyfus, Bruxelles, novembre 1896.
- Jean-Marie Charon, « Le journalisme d'investigation et la recherche d'une nouvelle légitimité », Hermès, Paris, CNRS Éditions, no 35 « Les journalistes ont-ils encore du pouvoir ? », , p. 137-144 (lire en ligne).
- Boussel, L'affaire Dreyfus et la presse, p. 82.
- Bredin, L'Affaire, p. 140.
- Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, p. 276.
- Sur la personnalité et la vie de Walsin Esterhazy, lire Reinach, Histoire de l'Affaire Dreyfus Tome 2, chapitre 1er et toute la première partie de L'Affaire sans Dreyfus de Marcel Thomas.
- Bredin, L'Affaire, p. 142. C'est Marcel Thomas qui a découvert cette lettre au début des années 1970. V. les annexes in L'Affaire sans Dreyfus.
- Bredin, L'Affaire, p. 144. Ce qui permet à l'État-Major de contester ouvertement la qualité de la preuve et de s'en prendre à Picquart pour le discréditer.
- Birnbaum, L'Affaire Dreyfus, p. 56.
- Au point que von Schwartzkoppen cesse ses relations avec Esterhazy dès le début 1896. Thomas, L'affaire sans Dreyfus, p. 145.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 2, p. 26.
- Ce qui pose la question de savoir s'il n'y a pas eu complicité entre les deux hommes. Bredin, L'Affaire, p. 144 et Thomas, L'Affaire sans Dreyfus p. 231, sont sceptiques.
- Lire Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, Chap. 1, « Le roman d'un tricheur ».
- Doise, Un secret bien gardé, p. 24 et s.
- v. articles de L'Éclair des 10 et , hostiles à Dreyfus, mai révélant l'existence du « dossier secret ». Bredin, L'Affaire, p. 163.
- Bredin, L'Affaire, p. 167.
- « Le télégramme de Panizzardi et l'affaire Dreyfus », sur www.bibmath.net, lire en ligne, consulté le 15 novembre 2021).
- Bredin, L'Affaire, p. 168.
- Ibid.
- Henry lui envoie une lettre pleine d'insinuations. Histoire de l'Affaire Dreyfus Tome 2 p. 517 et s.
- Doise, Un secret bien gardé, p. 109 et s.
- Bredin, L'Affaire p. 262).
- Bredin, L'Affaire, p. 200.
- Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, p. 475.
- Histoire de l'Affaire Dreyfus Tome 2, p. 603 et 644.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 82-83.
- Vincent Duclert, « Alfred Dreyfus, un dreyfusard méconnu », dans Gilles Manceron et Emmanuel Naquet (dir.), Être dreyfusard, hier et aujourd'hui, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 551 p. (ISBN 978-2-7535-0947-4, lire en ligne), p. 195.
- Pour tout ce paragraphe, hors précisions complémentaires : Winock, Le Siècle des intellectuels, p. 11-19.
- Zola, Combat pour Dreyfus, p. 44.
- Voir Chez l'Illustre Écrivain, qui paraît dans Le Journal le 28 novembre 1897, recueilli dans Octave Mirbeau, L'Affaire Dreyfus, 1991, p. 43-49.
- Michel Winock, Le Siècle des intellectuels, p. 29).
- Extraits de la séance du 4 décembre 1897, sur le site de l'Assemblée nationale.
- Bredin, L'Affaire, p. 207.
- Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, Tome 2, p. 244.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 39.
- Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, Tome 2, p. 245.
- Bredin, L'Affaire, p. 227.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 40.
- Dictionnaire de l'affaire Dreyfus, Thomas, entrée "Esterhazy en Angleterre".
- Procès Zola, Tome 1, p. 268.
- Bredin, L'Affaire, p. 234.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 42.
- Bredin, L'Affaire, p. 236.
- Sauf compléments, pour ce paragraphe : Winock, Le Siècle des intellectuels, p. 29-31.
- Michel Winock, Clemenceau, éditions Perrin, 2007, p. 254.
- Winock, Le Siècle des intellectuels, p. 35.
- Miquel, L'Affaire Dreyfus, p. 45.
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, Pagès, p. 143.
- Alain Pagès, Zola au Panthéon: l'épilogue de l'affaire Dreyfus, Presses Sorbonne Nouvelle, 2010, 264 p.
- Carpanin Marimoutou et Jean-Michel Racault, Métissages : Littérature-histoire, éditions L'Harmattan, 1992, 304 p.
- qui se font par une porte latérale du Quai des Orfèvres. Winock, Le Siècle des intellectuels, p. 36.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 44.
- Repiquet, bâtonnier de l'ordre, in Edgar Demange et Fernand Labori, Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, p. 273 et s.
- Voir l'intégralité des débats de 1898.
- Pierre Michel, Les Combats d'Octave Mirbeau, p. 342, Presses universitaires de Franche-Comté, 1993, 181 pages.
- Selon les souvenirs de l'antidreyfusard Arthur Meyer, Ce que mes yeux ont vu, Plon, 1912, p. 149.
- À partir de cette phrase et jusqu'à la fin du paragraphe suivant : Winock, Le Siècle des intellectuels, p. 39-41.
- F. Brown, Zola, une vie, Belfond, 1996, p. 779.
- Jules Renard, Journal 1887-1910, Gallimard, 1965, p. 472).
- V. Réception de l'affaire en Grande-Bretagne, États-Unis et Allemagne in Drouin, Dictionnaire de l'affaire Dreyfus.
- De cette phrase à la fin du paragraphe suivant, sauf précision contraire : Winock, Le Siècle des intellectuels, p. 50-51.
- Bredin, L'Affaire, p. 287.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 4, p. 5.
- Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, Tome 2, p. 262.
- Bredin, L'Affaire, p. 279. En 1894, il n'y en avait que quatre.
- Pour ce paragraphe et le suivant : Winock, Le Siècle des intellectuels, p. 49-51.
- Bredin, L'Affaire, p. 288.
- Duclert, l'Affaire Dreyfus, p. 48.
- Bredin, L'Affaire, p. 301.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 4, p. 183 et s.
- Miquel, l'Affaire Dreyfus, p. 74.
- Le chef d'escadron Walter, commandant du Mont-Valérien, « Annonce du suicide du lieutenant colonel Henry », Document militaire, sur dreyfus.culture.fr, Centre historique des Archives nationales, (consulté le ).
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 80.
- Procès de Rennes, Tome 1, p. 181 et s.
- Winock, Le Siècle des intellectuels, p. 52.
- Stephen Wilson, « Le monument Henry : la structure de l'antisémitisme en France, 1898-1899 », Annales, vol. 32-2, , p. 265-291 (lire en ligne)
- Dont Paul Valéry, Pierre Louÿs, et un Paul Léautaud ironique, qui joint le message : « Pour l'ordre, contre la justice et la vérité ». Winock, Le Siècle des intellectuels, p. 57.
- Miquel, L'Affaire Dreyfus, p. 92.
- Winock, Le Siècle des intellectuels, p. 63-65.
- Paul Ducatel, Histoire de la IIIe République vue à travers l'imagerie populaire et la presse satirique, t. III : La Belle époque (1891-1910), Paris, Jen Grassin, , 223 p., p. 87.
- Bredin, L'Affaire, p. 307.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 50.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 137.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 4, p. 358 et s.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 97.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 53.
- Pour ce paragraphe : [[#Demier|Francis Démier, La France du XIXe siècle]] p. 384-5.
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, Royer-Ozaman, p. 182.
- Miquel, L'Affaire Dreyfus, p. 91.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 4, p. 397 et s.
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, La première révision, Royer et Ozaman, p. 215.
- Boussel, L'affaire Dreyfus et la presse, p. 194.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 52.
- v. Débats de la cour de cassation en vue de la révision.
- v. arrêt de la Cour du 3 juin 1899.
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, Royer et Ozaman, p. 210.
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, Royer et Ozaman, p. 211.
- Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 543.
- Jean Jaurès, in L'Humanité du 4 juillet 1899.
- Mathieu Dreyfus, L'Affaire…, p. 206 et s.
- Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 562.
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, Joly, p. 231.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 60.
- Doise, Un secret bien gardé, p. 159.
- Bredin, L'Affaire, p. 544.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 61.
- Tillier 2009, p. 229.
- Bredin, L'Affaire, p. 395.
- Bredin, L'Affaire, p. 404.
- J.-D. Bredin, Bernard Lazare, le premier des dreyfusards, Éditions de Fallois, Paris 1992, p. 263.
- Miquel, L'Affaire Dreyfus, p. 114.
- Marc Riglet, « Deux siècles d'intégration », L'Express, (lire en ligne).
- Bredin, L'Affaire, p. 411.
- Bredin, L'Affaire, p. 414.
- Cinq années de ma vie, 1894-1899.
- Bredin, L'Affaire, p. 417.
- Doise, Un secret bien gardé, p. 160.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 104.
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, Becker, p. 262.
- Bertrand Favreau et Jacques Baudet, Dreyfus réhabilité, cent ans après : antisémitisme, il y a cent ans, et aujourd'hui, Latresne, Bord de l'eau, , 181 p. (ISBN 978-2-915651-73-7 et 2-915651-73-6, OCLC 152506022)
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, Becker, p. 267.
- Vincent Duclert, Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote, Paris, Fayard, , XII-1259 p. (ISBN 978-2-213-62795-3).
- Duclert, L'Affaire Dreyfus p. 108.
- Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 566.
- Cour de cassation, De la Justice dans l'affaire Dreyfus, Canivet, premier président, p. 12.
- Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 962.
- Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 1009.
- M. Drouin, Zola au Panthéon : La quatrième affaire Dreyfus, Librairie Académique Perrin, 2008, p. 287.
- Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 622.
- Drouin, Dictionnaire de l'affaire Dreyfus, entrée "Picquart", p. 263.
- Marie Duval, « Dreyfus au théâtre à l’heure de l’Affaire (1895-1906) Un engagement international pour des valeurs universelles », sur revues.mshparisnord.fr, (consulté le )
- Georges Clemenceau, « À l'étranger », L'Aurore, 17 février 1899
- Assia Kettani, « L’affaire Dreyfus au théâtre : à la recherche de l’universel », dans Théâtre et politique : Les alternatives de l’engagement, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », (ISBN 978-2-7535-5792-5, lire en ligne), p. 191–204
- Jaurès, discours à la Chambre 8 mai 1903.
- Birnbaum, L'Affaire Dreyfus, p. 94.
- Bredin, L'Affaire, p. 475.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 93.
- Birnbaum, L'Affaire Dreyfus, p. 95.
- « Au début même de ce grand drame, ce sont les socialistes révolutionnaires qui m'encourageaient le plus, qui m'engageaient le plus à entrer dans la bataille. » Jean Jaurès, "Les deux méthodes", 26 novembre 1900.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 67.
- Simon Epstein, Les Dreyfusards sous l'Occupation, Paris, Albin Michel, , 358 p. (ISBN 978-2-226-12225-4), p. 335-336.
- Vincent Duclert, La République imaginée : 1870-1914, Paris, Belin, coll. « Histoire de France » (no 11), , 861 p. (ISBN 978-2-7011-3388-1), p. 287.
- Duclert, L'Affaire Dreyfus, p. 95.
- Bredin, L'Affaire, p. 471.
- Boussel, L'affaire Dreyfus et la presse, p. 92.
- Bredin, L'Affaire, p. 474.
- Pierre Milza, L'affaire Dreyfus nelle relazioni franco-italiane (en italien), in: Comune di Forlì–Comune di Roma, Dreyfus. L'affaire e la Parigi fin de siècle nelle carte di un diplomatico italiano, Edizioni Lavoro, Roma 1994, p. 23-36.
- Benny Morris, Victimes. Histoire revisitée du conflit arabo-sioniste, 2003, p. 29 et 34.
- Dictionnaire de l'affaire Dreyfus, Nicault, entrée "Théodor Herzl et le sionisme", p. 505.
- Historiographie construite à partir de Thomas in Dictionnaire de l'affaire Dreyfus, p. 586 et Duclert, Biographie d'Alfred Dreyfus, p. 1193.
- Voir les 96 pages de la bibliographie générale publiée dans Drouin, Dictionnaire de l'affaire Dreyfus, p. 629.
- « Les souvenirs de Bernard Lazare sur son engagement dans l'affaire Dreyfus », sur le blog de la Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus, 2 janvier 2015.
- Joseph Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus.
- « "L'Histoire-canon". Au sujet de quelques ouvrages "du doute et du soupçon" », sur le blog de la Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus.
- Lire les recommandations bibliographiques chez Bach, Birnbaum, Bredin, Doise, Duclert, Drouin, Miquel.
- Rebérioux 1976, p. 406, n. 1.
- L'affaire Dreyfus. La clef du mystère, Paris, Robert Lafon, « Les ombres de l'histoire », 1972.
- L'Île des Pingouins.
- Édition originale en ligne sur Gallica, BnF :
- (nl) « Anton van Sprinkhuysen », sur TheaterEncyclopedie, (consulté le )
- Marie Duval, « L’affaire Dreyfus sur la scène internationale : cinéma et censure », Double jeu. Théâtre / Cinéma, no 17, , p. 13–36 (ISSN 1762-0597, DOI 10.4000/doublejeu.2715, lire en ligne, consulté le )
- Portail de la France au XIXe siècle
- Portail des années 1890
- Portail de l’histoire militaire
- Portail du droit français
- Portail du renseignement
- Portail de la culture juive et du judaïsme
- Portail de l’Armée française
- Portail de la politique française
- Portail de l’histoire
- Portail de la littérature française